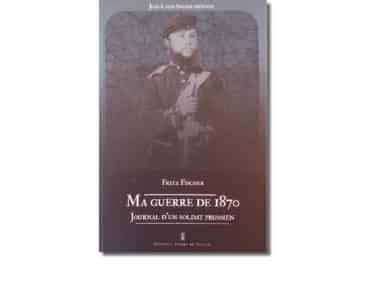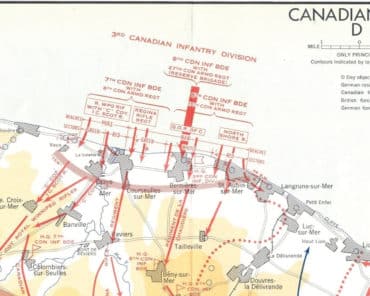L’obstination de Lincoln
Le 29 juin, lors d’une conférence stratégique à la Maison Blanche, le général Irwin McDowell fait valoir l’ensemble des carences qui affecte son armée. Il veut différer l’offensive contre Richmond afin de former les volontaires engagés pour trois ans.
Pour ce faire, il tente de convaincre Lincoln que l’armée ne sera pas opérationnelle avant l’automne. Scott le soutient tout mettant de l’avant son plan Anaconda. Mais ils sont bien seuls. Tous, à commencer par Lincoln, souhaitent que l’offensive débute en juillet. McDowell répète que ses hommes manquent d’entraînement, que ce sont encore des novices.
Lincoln lui répond : « Vous êtes des novices, c’est vrai, mais eux aussi sont des novices : vous êtes des novices les uns comme les autres. »
Or, Lincoln et son cabinet ne comprennent pas que les hommes devront marcher jusqu’à Manassas Junction, là où Gustave Toutant Beauregard, le général sudiste, a concentré sa petite armée. Comment vont-ils supporter la marche? Dans quel état seront les régiments lorsqu’ils arriveront face à l’ennemi? Si McDowell a demandé quelques semaines de plus afin de différer la campagne, c’est aussi parce que l’engagement des volontaires de trois mois arrive à terme. À quelques semaines de la libération, comment vont-ils se comporter lorsque viendra le temps de partir en campagne? Il le répète, il faut impérativement former ceux qui se sont engagés pour trois ans pour remplacer les autres qui ne manqueront pas de quitter le service.
Mais dans le cas présent, c’est l’opinion publique qui mène la danse et les politiciens, Lincoln le premier, sont à sa botte. McDowell devra faire avec ce qu’il a sous la main. Et s’il ne veut pas perdre les hommes dont le contrat d’engagement est à la veille d’expirer, il doit précipiter les choses. Son plan de campagne est lui aussi d’inspiration napoléonienne. Quarante ans après sa mort, l’empereur reste la référence en matière de tactique. Le général McDowell compte donc attaquer Beauregard sur ses arrières à Manassas.
Cependant, la bonne marche du plan dépend principalement du général Patterson à Harpers Ferry. Il doit occuper Johnston à Winchester afin de l’empêcher de rejoindre Beauregard. Mais à 72 ans, l’homme n’a plus l’énergie qu’il avait lors des guerres de 1812 et du Mexique. Afin de satisfaire
la volonté du public et du président, McDowell a prévu entrer en cam- pagne le 8 juillet. Mais il lui manque toujours ses fourgons de ravitaillement. Par ailleurs, il n’a pas terminé l’embrigadement de ses régiments et la formation de ses divisions. Ce n’est que le 16 juillet, après avoir paradé dans Washington, toujours pour satisfaire le public, que lui et son armée de 35 000 hommes se mettent en marche. Le lendemain matin, tous les journaux de Washington annoncent que McDowell et son armée sont en marche pour Richmond. À Manassas, Beauregard met la main sur une copie de l’un des journaux qui diffuse la nouvelle. L’information lui est confirmée dans la nuit par l’espionne Rose Greenhow, une « Belle du Sud » dont la demeure est située à quelques rues seulement de la Maison blanche.
Beauregard télégraphie aussitôt à Jefferson Davis. Il l’informe que les nordistes marchent sur lui. Il a déjà donné l’ordre à tous les avant-postes, dont la brigade du général Bonham établie à Fairfax, de se retirer sur la ligne Bull Run-Manassas. Davis le rassure et lui dit que les renforts vont bientôt arriver. En effet, Johnston et ses hommes sont déjà en route. En passant par le col de Ashby qui permet de franchir les Blue Ridge, ils marchent jusqu’à la petite gare de Piedmont située à 40 kilomètres au sud-est de Winchester. De là, ils montent dans le train qui doit les mener à Manassas Junction.
Le même jour, à Harpers Ferry, le général Robert Patterson, qui a maintenant 18 000 hommes sous ses ordres, ne se doute de rien. Croyant à tort que les forces confédérées sont « grandement » supérieures aux siennes, il décide de rester sur la défensive et cela, en dépit des abjurations de
Scott de passer à l’attaque. Abusé par un mince rideau de cavalerie mis en place par J.E.B Stuart, il laisse filer le général Joseph E. Johnston et ses 11 000 hommes. Les plans de McDowell s’écroulent. Le général nordiste ne sait pas encore qu’il ne dispose plus de la supériorité numérique. Sur le plan qualitatif, Beauregard et Johnston détiennent aussi l’avantage, car leurs soldats sont parfaitement reposés. Ils n’ont pas été éprouvés par la marche.
Pendant ce temps, l’armée nordiste marche depuis Alexandria jusqu’à Centreville en passant par Fairfax Court House. Il leur faudra trois jours pour couvrir 38 kilomètres.
Au début du siècle, les hommes de Napoléon couvraient cette distance en moins d’une journée. Dans le langage napoléonien, une « marche » correspondait à 25 kilomètres. Mais les Grognards pouvaient marcher davantage. Lors de la campagne de 1805, il faudra dix heures à la division du général Friant afin de parcourir les 120 kilomètres qui le sépare du champ de bataille d’Austerlitz. Mais contrairement aux soldats américains de 1861, les Français ne s’arrêtaient pas toutes les heures pour se reposer. Ils ne quittaient pas leur régiment afin de s’empiffrer de petits fruits ou pour chercher de l’eau dans la rivière. Au cours de ces trois jours de marche, il n’est pas rare de croiser des soldats traînant sur la route la bouche toute barbouillée par les mûres qu’ils viennent de manger. À chaque halte, toute l’armée s’arrête, faisant le pied de grue sous le soleil. Pour passer le temps, ils mangent leurs rations sans se demander ce qu’ils auront le lendemain. Au départ, chaque soldat disposait de quatre jours de vivre. Lorsque l’armée arrive à Centreville, le 18 juillet, les hommes n’ont plus rien à manger.
Combat pour Matthew’s Hill
Le 20 juillet au soir, le général McDowell dresse son plan de bataille. Il va manœuvrer sur la gauche de Beau- regard. Et pour ce faire, il ordonne au général Dixon Miles de rester avec sa division à Centreville. Son objectif est de fixer le gros des forces confédérées à Blackburn’s Ford. À 2 h 30, l’armée se met en marche. Pendant ce temps, le général Tyler doit porter sa division jusqu’au pont de pierre et forcer le passage. Quant à l’attaque principale, elle est conduite par les généraux Hunter et Heintzelmann qui doivent mener leur division respective, soit 12 000 hommes, à Sudeley Ford. Là, ils doivent traverser le Bull Run et se porter sur les arrières de l’ennemi sur la colline Henry House afin de marcher sur Manassas Junction. De leur côté, Beauregard et Johnston s’apprêtent eux aussi à lancer une attaque.
Ils comptent se porter sur la gauche des fédéraux à Centreville. Mais tous les hommes de Johnston ne sont pas encore arrivés. Au matin du 21, à 6 h 30, Tyler, qui devait attaquer deux heures plus tôt, ouvre le feu sur les positions sudistes au pont de pierre.
Pour le moment, il s’agit de quelques coups de canon tirés depuis la rive opposée de la rivière. Mais, c’est suffisant pour fixer la brigade du général Nathan Georges Evans. À un kilomètre plus au nord, le Tout- Washington est là. On vient assister à la déroute probable des rebelles. Sur place, les cochers des beaux carrosses et des berlines de luxe se bousculent afin de trouver un espace pour se garer.
Accompagnés par de jolies femmes habillées à la dernière mode, les hommes, hauts de formes vissés sur la tête, armée de jumelles, tentent d’apercevoir les combats.
Les femmes ne sont pas moins curieuses. Elles aussi, petites jumelles de théâtre en mains, cherchent vainement le déroulement de l’action. Malheureusement, la fumée cache tout le « spectacle ».
La déception est grande. Car toutes et tous comprennent qu’une bataille n’a rien de commun avec les grandes fresques héroïques que l’on retrouve dans les musées. Mais peu importe, nombreux sont ceux qui ont pris la peine d’apporter sandwichs et boissons. À défaut de voir la bataille, ils doivent se résoudre à pique-niquer dans les champs. Pendant ce temps, alors que les combats s’engagent au pont de pierre, plus loin sur la gauche, les troupes de Heintzelmann et de Hunter remontent la rivière Bull Run jusqu’à Sudeley Ford. Par contre, la distance est beaucoup plus longue que prévu. Il leur faut trois heures avant d’atteindre l’objectif. Néanmoins, Beauregard ne soupçonne absolu- ment rien du mouvement tournant qui s’opère sur sa gauche. Trompé par la canonnade de Tyler, il croit que les Yankees vont tenter de traverser le pont. Il compte toujours se porter sur la gauche de McDowell et marcher sur Centreville. Il décide de ramener la brigade du général Cooke afin de soutenir Evans.
Mais après trois heures de canonnade, Evans comprend que l’objectif des fédéraux n’est pas de traverser le pont. Il voit le danger qui se profile sur la gauche. Sans plus tarder, il laisse quatre compagnies devant le pont et porte le reste de ses troupes, par la route de Warrenton jusqu’à celle de Sudeley Ford, là où Hunter et Heintzelmann ont commencé à traverser.
À l’intersection de ces deux routes, Evans, qui a réussi à devancer l’ennemi, prend position sur Matthews Hill, une petite hauteur qui devrait lui permettre de compenser son infériorité numérique et de tenir jusqu’à l’arrivée des renforts. Depuis l’arrière, McDowell ne comprend pas pourquoi ses troupes n’avancent plus. Il chevauche jusqu’en avant et là, il trouve la brigade du général Burnside au repos.
Fatigués par sept heures de marche, les hommes se sont arrêtés pour manger et boire de l’eau. McDowell secoue son subordonné et la brigade se remet en marche. Ce n’est que vers 10 h que les colonnes de Burnside entrent en contact avec les rebelles. Elle tombe sur les tirailleurs sudistes et bientôt, sur les soldats d’Evans. Ils sont plus de mille rangés en ligne sur la hauteur qui domine l’intersection. L’action véritable commence. Desservis par leur inexpérience, les soldats nordistes ouvrent le feu sans même prendre le temps de se mettre en ligne. De l’autre côté, vêtues de leurs uniformes aux couleurs hétéroclites, soit du gris, du brun et même du bleu, certains sont en civil, les hommes d’Evans n’ont aucune difficulté à tenir leur position.
Mais cela ne saurait durer. La brigade du général Andrew Porter arrive avec ses réguliers sur les lieux afin de soutenir Burnside. Après trois quarts d’heure de fusillade, Evans et ses hommes commencent à plier.
Alors que les nordistes mettent de plus en plus la pression sur sa gauche, Beauregard reste persuadé que l’offensive principale viendra du pont. Derrière le Bull Run, il n’a aucune vue d’ensemble sur ce qui se passe sur le terrain. À sa décharge, il est vrai que son service d’état-major est pratiquement inexistant. En outre, il est abusé à Blackburn’s Ford par les tirs d’artillerie particulièrement efficace des divisions Miles et Richardson. Il décide d’envoyer au petit pont les deux brigades des généraux Bee et Bartow, soit 2800 hommes. Dans le même temps, la 1ere brigade de Thomas Jackson prend position entre celles des généraux Cooke et Bonham. Mais à l’extrême gauche, Evans peine de plus en plus à contenir les nordistes qui viennent de mettre une batterie d’artillerie en ligne. Il fait parvenir un message à Bee et à Bartow afin de les informer de la situation. Ces derniers obliquent leur marche vers la gauche. C’est au pas de course qu’ils parcourent les 2800 mètres qui les séparent. Entre temps, Burnside et Porter abordent les hauteurs. Les bleus sont sur le point de l’emporter. Mais à 11 h 30, le général Bee et sa brigade arrivent sur place. Il forme sa ligne de combat et stoppe les nordistes. Bartow prend position sur sa droite. Du côté nordiste, en dépit de leur supériorité numérique sur ce point, environ 5800 hommes, on hésite toujours à se lancer dans l’assaut. Cette hésitation est d’autant plus grande que le général Hunter a été blessé dès le début des combats.
La position des confédérés est des plus avantageuses. Ils sont en ligne sur un plateau qui domine de 40 à 50 mètres le Bull Run. En outre, les nordistes ont devant eux une série de clôtures qui sont autant d’obstacles qui ne manqueront pas d’entraver leur progression. Mais, Tyler a décidé de porter la brigade du colonel Sherman en avant.
Un peu plus tôt dans la journée, il a trouvé un gué à 500 mètres au nord du petit pont. De là, il va pouvoir prendre la ligne confédérée par le flanc. Afin de marcher plus rapidement, il laisse son artillerie derrière lui. En face, Tyler relève la brigade Burnside par des troupes fraîches. L’attaque est lancée.
Les sudistes sont pris à partie sur leur droite par Sherman. Heintzelmann et Tyler relancent l’assaut en face de Matthews Hill. L’artillerie commence à faire des ravages. Les sudistes doivent abandonner leurs positions.
Alors que les sudistes reculent, les bleues en profitent pour avancer. Plus bas, sur le petit pont de pierre, l’une des brigades de Tyler, celle du général Schenck, dégage les abattis qui l’encombrent et traverse le Bull Run.
Henry House Hill
Les nordistes ayant pris Matthews Hill, ils marchent sur Henry House Hill, la dernière ligne de défense des confédérés. L’artillerie du colonel James Ricketts, alors en ligne face aux rangs sudistes, les canonne à bout portant. Graduellement, ces derniers reculent jusqu’à la maison de Judith Carter Henry où leur artillerie livre un duel acharné avec celle des Yankees. La petite maison blanche est traversée de nombreux projectiles dont l’un blesse mortellement la vieille dame grabataire de 84 ans.
Elle avait refusé d’évacuer sa maison.
McDowell est sur le point de l’emporter. Il suffit d’un dernier coup de boutoir afin de disloquer l’armée de Beauregard. Mais ce dernier réagit. Informé que l’action se déroule sur la gauche, il donne l’ordre aux brigades des généraux Holmes, Early et celle de Bonham, une partie du moins, de
remonter jusqu’à Henry House Hill.
Jackson et sa 1ere brigade sont déjà sur place. En contre bas, il voit les troupes de Bee et Bartow perdre pied et prendre la fuite. Lui et ses 2600 Virginiens se mettent en ligne. Avec son uniforme de l’Union sur le dos, le contraste avec ses troupes est assez frappant. Toujours en contrebas de Henry House Hill,…
… Bee tente de rallier ses hommes. En désespoir de cause, il leur crie : « Voici Jackson qui se tient là comme un mur de pierre! Ralliez- vous derrière les Virginiens! »
Pour la postérité, Thomas Jackson devient « Stonewall Jackson ». Après avoir prononcé ces paroles qui n’étaient sûrement pas destinées à entrer dans l’histoire, Barnard Bee est mortellement atteint par un boulet en pleine poitrine. Francis Bartow tombe quelques instants plus tard.
Les troupes de l’Union gagnent rapidement du terrain. Ils atteignent la maison de Mme Carter Henry et celle d’un ancien esclave, un fermier nommé James « Gentleman Jim » Robinson. Située à la droite du plateau, elle devient le théâtre de combats acharnés. Pris et repris à plusieurs reprises, traversée par de nombreux projectiles, aucun soldat ne peut s’y maintenir très longtemps. Heureusement, Robinson a pris la précaution de se cacher avec sa famille sous un pont qui enjambe le Young Branch. Derrière la maison de Mme Carter Henry, ne bougeant pas d’un pouce, Jackson et sa brigade subissent les tirs meurtriers de l’artillerie. Lui-même est légèrement blessé à une main. Mais au moment où ils entrent au contact des nordistes, ils envoient quelques salves qui stoppent net leur avancée. Plus haut, les quatre canons du capitaine Imboden les soutient. Les troupes de McDowell commencent à montrer des signes d’épuisement, son armée perd le peu de cohésion qu’elle avait.
Cela fait onze heures que les hommes sont au combat, ils n’ont rien bu ni manger. La chaleur les accable. La motivation n’y est plus. Les rangs peinent à se reformer. Johnston et Beauregard profitent de l’occasion afin de faire venir davantage de renforts et réorganiser les fuyards. Or, la situation n’est guère brillante. La brigade Jackson est presque décimée et beaucoup d’officiers supérieurs sont morts ou blessés. La légion de Wade Hampton, qui a beaucoup souffert près de la maison Robinson, n’est pas en meilleur état.
Les pertes sont lourdes.
Si McDowell avait su profiter de cet instant de flottement, il écrasait sans difficulté la ligne sudiste. Le sort d’une bataille ne tient souvent qu’à très peu de choses. Il suffit de quelques minutes pour en renverser le cours. Enfin, les deux généraux sudistes réunissent tout ce qu’ils ont sur la main, soit 18 000 hommes, le même nombre que les nordistes dont la totalité a maintenant traversé le Bull Run.
Mais contrairement à ces derniers, les troupes sont reposées. Le général Beauregard ordonne la contre-attaque.
Aussitôt, Jackson intime l’ordre à ses hommes de crier comme des furies. Le « Rebel Yell », ou le « cri des rebelles » qui hantera tous les champs de bataille, se communique aussitôt à l’ensemble de l’armée.
Il est aujourd’hui très difficile de s’en faire une idée. Il s’agissait très probablement d’un hurlement inspiré de celui des Comanches et des cris poussés lors des chasses à court. Toutefois, l’effet psychologique est instantané sur les nordistes. Après la guerre,
certains vétérans de la bataille diront avoir ressenti un frisson remonter depuis le bas de la colonne vertébrale jusqu’à la pointe des cheveux.
Dès lors, épuisés par toute une journée de combat, le moral dans les talons, les fédéraux reculent et se débandent.
Leur contrat d’engagement arrivant à terme, certains laissent même tom- ber leurs armes et s’enfuient à toutes jambes. Les zouaves de New York tentent de maintenir leur position, mais ils sont chargés sur le flanc par la cavalerie de J.E.B Stuart et littéralement écrasés. Seule l’arrivée des escadrons du capitaine Coburn permet à ce qui reste de ces pauvres pompiers de s’enfuir. Toutefois, en dépit de cette action retardatrice, la cavalerie de Stuart s’empare de nombreux prisonniers, de caissons de munitions et de fourgons de ravitaillement. Impuissant, McDowell voit son armée gagnée par la panique. C’est le sauve qui- peut général. Tous n’ont qu’un but : repasser le Bull Run le plus vite possible. Inévitablement, la traversée du cours d’eau, surtout au niveau du pont de pierre, augmente la confusion dans les rangs. Dans une cohue indescriptible, les soldats en fuite se mêlent bientôt aux civils qui, eux aussi, gagnés par la panique, tentent par tous les moyens de rejoindre Washington.
Le beau monde se mêle sans distinction aux soldats sales et hirsutes qui fuient vers le nord. Empêtrées dans leurs robes de dentelles, poussées par les soldats qui se ruent en masse vers l’arrière, certaines femmes sont bousculées et tombent face contre terre. Des hommes passent tout près sans les regarder. Dans ces instants de chaos, la galanterie n’a plus cour.
Certains cochers abandonnent même leurs beaux équipages pour prendre leurs jambes à leur coup. Berlines et carrosses sont autant d’obstacles laissés en travers de la route.
À Richmond, Jefferson Davis plonge dans les pires inquiétudes. Il est sans nouvelle depuis des heures. Toujours sous l’impression des premiers rapports pessimistes de la matinée, il ne sait pas comment tourne la bataille.
Les Yankees ont-ils enfoncé l’armée de Beauregard? Va-t-il falloir évacuer Richmond? Pour en avoir le cœur net, il décide de se rendre à Manassas par train spécial.
Lorsqu’il arrive sur place vers 17 h, il voit les blessés allongés par terre au milieu des caissons éventrés et des chariots abandonnés. Tout en marchant vers la ligne de front, il croise les rescapés des brigades Evans, Bee et Bartow. Sans ménagement, ils lui font part de leur découragement.
Ils lui disent que tout est perdu. Davis craint le pire. Mais très vite, alors qu’il arrive sur Henry Hill House, on lui annonce que la bataille est gagnée.
De l’autre côté du champ de bataille, sur la route de Centreville, les officiers tentent de rassembler tous ces fuyards au visage noirci par la poudre.
Même des députés du Congrès sont de la partie et tentent d’y remettre bon ordre. Mais rien n’y fait. Les yeux hagards, ils sont moralement atteints.
Et plus ils fuient, plus ils ont peur.
Le Potomac devient l’ultime barrière psychologique à franchir.
En attendant, les pertes sont élevées: 462 morts, 1124 blessés et plus de 1300 prisonniers. Presque toute l’artillerie et la plupart des caissons de munitions sont tombées aux mains des confédérés. Vingt-cinq canons sont perdus. « Les hommes, écrit McDowell après la bataille, refluent
dans la plus grande confusion. Ils sont complètement démoralisés. L’opinion de l’ensemble des commandants est à l’effet qu’il faut ramener l’armée de l’autre côté du Potomac. » Néanmoins, à la faveur de la nuit, McDowell réussit à rétablir une ligne de défense en face de Centreville. Heureusement, il dispose toujours de la division du général Runyon qui n’a pas été engagée dans la bataille et des brigades des généraux Porter et Schenck. Une ligne bien faible puisqu’il n’a plus de munition d’artillerie ni de nourriture pour ses soldats qui n’ont rien avalé depuis le matin. De son côté, Beauregard dénombre 378 morts, 1489 blessés et 30 manquants dont 13 prisonniers. Au lendemain de la bataille, les confédérés se sont demandés s’ils auraient pu prendre Washington. Jackson en était persuadé.
Il a dit à Beauregard : « Donnez- moi 5000 hommes et je prends Washington. »
Dans les faits, l’armée de Beauregard n’était pas en mesure de se lancer dans une campagne offensive, car au cours de la bataille, toutes les brigades ont soufferts du combat.
D’abord désorganisée par la défaite qui semblait se profiler dans la matinée, elle le fut davantage par la victoire de l’après-midi. En outre, et c’est là une donnée d’importance, les sudistes n’avaient pas le système logistique nécessaire pour assurer le ravitaillement d’une armée en campagne.
De plus, elle n’a pas la coordination voulue pour mener ce genre d’offensive. Il faudra l’arrivée du général Lee pour faire de cet agrégat de régiments et de brigade une véritable armée. Somme toute, on en revient aux réserves exprimées par Davis lorsque Beauregard, on s’en souviendra, a souhaité prendre l’offensive.
Dans toute guerre, la chance, concept imperceptible, voire intangible, joue un rôle déterminant et malheureusement pour lui, Irvin McDowell est un général malchanceux. Dès le départ, il n’a pas eu le soutien de son gouvernement.
Lincoln et son cabinet n’ont pas voulu entendre ses mises en garde sur l’impréparation manifeste de l’armée. En cela, le président est le premier responsable de la défaite.
Après coup, il comprend que la guerre ne s’improvise pas, qu’une campagne militaire demande beaucoup de préparation. Après avoir relevé McDowell, tous les moyens sont pris pour mener une guerre longue. Dès le lendemain de la bataille de Bull Run, Lincoln signe un projet de loi qui permet l’enrôlement de 500 000 hommes pour trois ans.
Il est adopté par le Congrès trois semaines plus tard. Le 5 août, le Congrès autorise un emprunt de 140 millions de dollars à 6 % d’intérêt. Le même jour, un impôt sur le revenu est décrété. Tous les habitants gagnant plus de 800 $ par année devront verser 3 % de leur revenu à l’État. Mais
avec les coûts astronomiques de l’effort de guerre, le 25 février 1862, le Congrès accepte un nouvel emprunt de 500 000 millions de dollars à 6 % d’intérêts. Dans la foulée, Salmond P. Chase autorise la création d’un papier-monnaie, le « Green Back ». Se détaillant en coupure de 5 $ à 1000$, le gouvernement en imprime pour 150 millions. Il entre en vigueur le 1er mars 1862. D’abord destiné à l’achat de bons du Trésor, cette monnaie aura bientôt cour légale dans l’ensemble du pays. C’est la naissance du billet vert américain.
Il faut rappeler que l’ensemble de ces mesures provient de « l’électrochoc » causé par la déroute de Bull Run. Le Nord prend conscience du sérieux de cette guerre et des innombrables difficultés qu’il faudra surmonter afin de la gagner. Dans une certaine mesure, la défaite a eu un impact positif sur l’opinion nordiste. De façon paradoxale, l’arrogance change de camp. Car si les nordistes reviennent de leurs illusions de victoire facile, les sudistes croient qu’ils sont désormais invincibles. Ils estiment avoir gagné leur indépendance. À l’évidence, l’ivresse de cette victoire à l’arraché leur fait perdre contact avec la réalité. Ils n’ont pas conscience des immenses ressources humaines, financières et matérielles que le Nord est en train de déployer.
La guerre industrielle est née.

Conçu par le général Winfield Scott, vétéran de la guerre de 1812 et du Mexique, ce plan visait à enserrer le Sud par l’effet d’un blocus de l’ensemble des ports. Dans la deuxième phase, les armées devaient progresser le long du Mississippi afin de s’en emparer. Il s’agit d’un plan d’asphyxie économique.
Or, ce plan ne sera pas adopté, car il suppose une guerre longue. Mais après la bataille de Bull Run, il va s’imposer par la force des choses.