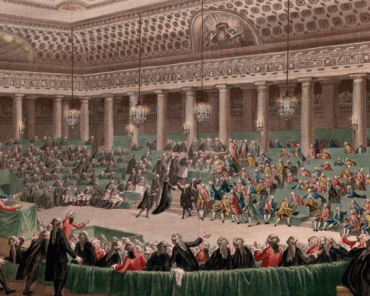Un horizon d’attente, des réalisations diverses
Article publié dans Histoire Magazine N°11
L’apparition des premières Assemblées politiques a marqué de manière indélébile la naissance de la démocratie moderne. L’Assemblée nationale constituante en France en 1789 en offre l’exemple le plus spectaculaire malgré les incontestables limites de l’expérience (notamment en termes de droit de suffrage). Le parlementarisme est cependant quelque chose de plus précis et de plus décisif pour comprendre la nature de la politique moderne. Ce n’est pas la simple désignation d’un régime politique doté d’un Parlement, ni même d’un Parlement à pouvoir fort (cas de l’Angleterre depuis les deux révolutions du XVIIe siècle) :
le parlementarisme désigne de façon beaucoup plus qualitative une manière d’orienter la politique moderne dans le sens de la primauté de la loi.
Cette primauté a vocation à s’imposer par la méthode de la discussion et l’échange d’arguments (d’où le nom de « démocratie délibérative ») ainsi que par la réduction drastique de la place et du rôle du pouvoir exécutif. Le rejet d’un « pouvoir personnel » associé au souvenir de la monarchie absolue est un élément essentiel. Dans un certain sens, on peut dire que le parlementarisme renvoie à un horizon de nature utopique se donnant comme but de placer la totalité des décisions ou affaires publiques dans le cadre de lois discutées au Parlement plutôt que dans celui de décrets, règlements ou ordonnances produits par le pouvoir exécutif.
Cet idéal à caractère utopique n’a jamais été complètement réalisé au XIXe siècle, et encore moins au XXe siècle. On peut considérer cependant que le régime républicain français, entre la Troisième République (1870-1940) et la Quatrième République (1946-1958), a pu l’approcher d’assez près. C’est d’ailleurs un cas assez unique en Europe. Dans d’autres pays, comme en Grande-Bretagne, la discipline de vote des parlementaires est apparue assez tôt, avec pour effet de restreindre le rôle du « gouvernement de la discussion ». Dans l’Allemagne impériale, après 1871, le Reichstag est bien élu au suffrage universel, mais il ne tient pas dans sa dépendance stricte le pouvoir exécutif : le chancelier est responsable devant l’Empereur et non devant le Reichstag. Ce mécanisme de « responsabilité » de l’exécutif qui s’accompagne de la chute de gouvernement à la suite de votes de défiance par le Parlement offre la définition technique et juridique la plus descriptive du « parlementarisme ». En ce sens, dans le cas des États-Unis, on ne peut pas parler de « parlementarisme » en raison de l’absence d’un tel mécanisme de responsabilité de l’exécutif présidentiel (hors de la responsabilité particulière qui peut déclencher la procédure d’impeachment contre un Président). Pourtant, le Congrès a connu de longues périodes durant lesquelles il dominait la vie politique (ce que le futur président Wilson avait dénoncé par le terme de « gouvernement congressionnel »). Les représentants et les sénateurs ont pu bénéficier et bénéficient toujours aujourd’hui d’une certaine liberté de vote vis-à-vis de leur parti politique d’affiliation ; à savoir l’un des deux grands partis historiques, le Parti républicain et le Parti démocrate. Parfois, ils la retournent contre un Président comme le soulignent les exemples de « shutdown », c’est-à-dire de la paralysie du vote du budget (contre le Président Trump en janvier 2019, par exemple). Il peut donc y avoir un Parlement fort sans que l’on soit à strictement parler dans le cadre d’un régime parlementaire.
Les situations sont donc diverses d’un pays à l’autre. Le cas français, sur lequel nous allons maintenant nous concentrer, a l’avantage d’offrir le contraste historique le plus frappant avec, d’une part une période dominée par la force du parlementarisme (de la fin du XIXe au milieu du XXe siècle) et, d’autre part, un temps ouvert en 1958, avec la fondation de la Cinquième République, où s’opère une sorte de relégation du parlementarisme et une forte domination de l’exécutif.

Jules Ferry en matador au centre, Georges Clemenveau à droite du dessin et Henri Brisson sur le perchoir, à la Chambre des députés. Dessin satirique relatif à la guerre franco-chinoise, Le Triboulet, 23 décembre 1883
L’âge d’or du parlementarisme en France
Plusieurs changements y ont placé, à partir de la fin du XVIIIe siècle, les Parlements au centre des régimes modernes. Cette position privilégiée explique pourquoi démocratie et parlementarisme ont été identifiés l’un à l’autre pendant une longue période entre les milieux du XIXe et du XXe siècles.
La première explication, la plus spectaculaire, tient dans l’accroissement de la masse législative. Les parlements modernes prennent à leur charge un nombre de plus en plus considérable de réformes et de nouvelles mesures publiques qui passent par le travail de leurs commissions, les débats en séances et par les lois votées au Parlement. Les domaines concernés sont de plus en plus nombreux, depuis les conditions mêmes de la nouvelle vie politique (libertés individuelles et civiles, lois sur la presse et électorales etc.), jusqu’aux conditions de travail et de vie sociale (régulation du temps de travail ouvrier, par exemple) en passant par les conditions de la vie administrative. La toute première Assemblée nationale née de la Révolution de 1789 a ainsi accompli un travail considérable dont les exemples les plus connus vont de la création des départements à la nationalisation des biens du clergé en passant par la réforme du système judiciaire et la complète refonte du système des impôts, sans oublier l’œuvre constitutionnelle proprement dite : Déclaration des droits de l’homme (26 août 1789), Constitution civile du clergé (12 juillet 1790), première Constitution de septembre 1791. Le plus remarquable est que, malgré le chaos lié aux divisions politiques, bientôt au gouvernement de la Terreur (1793-1794), l’œuvre de production législative a continué aussi bien avec l’Assemblée législative (octobre 1791-septembre 1792) qu’avec la Convention républicaine (septembre 1792-octobre 1795). L’exemple des réformes et des créations dans le domaine de l’enseignement est significatif de cet activisme parlementaire.
Même si le rythme est moins intense, tous les régimes du XIXe siècle, Restauration, monarchie de Juillet ou Second Empire, ont continué d’accorder aux différentes formes d’assemblées cette fonction d’élaboration, de discussion et de vote des réformes les plus importantes. La loi Guizot de juin 1833 peut être citée ici en exemple : elle a joué un rôle décisif dans le développement de l’enseignement primaire avec notamment la création des Écoles normales d’instituteurs. Mais c’est incontestablement le régime républicain moderne, fondé sur les lois constitutionnelles de 1875 et sur la domination électorale des républicains (à partir de 1876-1877), qui impose la force parlementaire de production de grandes lois modernes. La loi sur la presse de 1881, les lois scolaires dites de Jules Ferry du début des années 1880, et les premières lois sociales du début du XXe siècle sont les plus connues. Le plus important est de souligner que lors des discussions parlementaires, le travail dans les commissions et les votes en séance jouent un rôle plus important que les volontés exprimées par le gouvernement. Ainsi des textes de réforme préparés dans les « bureaux » de ministères se retrouvent considérablement modifiés une fois passés par les assemblées (et leurs commissions), comme ce fut le cas pour la loi sur les associations de 1901 qui est toujours en vigueur. Plus remarquable encore, …
… des lois essentielles sont nées de l’initiative des parlementaires et non de l’exécutif comme le montre la loi sur la Séparation des Églises et de l’État de décembre 1905.

Publication au Journal officiel de la loi sur les associations de 1901, toujours en vigueur. Doc.Assemblée nationale.
Le rôle clef y a été joué par le rapporteur de la commission (Aristide Briand qui connaît là son premier succès politique) et non par le ministre ou le président du Conseil du moment.
La deuxième raison qui explique la force des Parlements est liée à la conquête démocratique du droit de suffrage. En Grande-Bretagne, les réformes successives qui ont permis de sortir d’un suffrage archaïque et très fortement élitiste (1832, 1867, 1884 puis 1918) ont accompagné la montée en puissance (et en légitimité populaire) du Parlement de Westminster. Mais c’est en France que le changement a été le plus spectaculaire en raison du passage soudain au suffrage universel (encore limité aux hommes de 21 ans ou plus) par le décret du 5 mars 1848. À noter que ce suffrage élargi peut aussi être pratiqué par des régimes semi-autoritaires comme le Second Empire français après 1852 ou le Reich allemand après 1871, ce qui explique une certaine capacité politique des assemblées y compris face à un exécutif puissant, notamment lors des discussions budgétaires.
Si les assemblées parlementaires avaient déjà pu développer leurs procédures et leurs méthodes de travail (comme en Grande-Bretagne et dans la France de la Restauration et de la monarchie de Juillet), c’est incontestablement ce lien avec la légitimité électorale et populaire qui leur donne la place centrale dans les régimes de démocratie libérale. Elles sont donc au cœur de la définition de la démocratie dite représentative. En France, sous la Troisième République (à la suite de la Révolution de 1789) le surnom donné au Parlement (et surtout à la Chambre des députés) est celui de « représentation nationale » ou, mieux, de « nation assemblée » : cela souligne que, …
…grâce au suffrage et à la pratique des élections libres, l’existence même des assemblées parlementaires fait exister de manière performative (et non pas seulement métaphorique) la nation politique.
La troisième et dernière explication de la force du parlementarisme entre le milieu des XIXe et XXe siècles, tient dans la relation qui s’est instituée entre ce que la tradition philosophique libérale a appelé le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif. Ici, le parlementarisme peut être défini par la relation asymétrique entre les pouvoirs, au profit de la force des assemblées, et au détriment des gouvernements dont on se méfie. Comme on le voit abondamment sous la Troisième République, le gouvernement est placé sous la dépendance des votes de confiance (ou de défiance) des deux assemblées. Un président du Conseil qui à la suite d’un débat (notamment d’interpellation où sa politique peut être critiquée) perd la confiance de sa majorité doit obligatoirement donner sa démission et respecter « la volonté de la représentation nationale ». En mars 1885, lors d’un des épisodes les plus célèbres de « chute » ministérielle, le président du Conseil, Jules Ferry, avait perdu la confiance de la Chambre à la suite de débats portant sur sa politique coloniale (au Tonkin). Ce qui prouvait deux choses : la capacité de l’assemblée à demander des comptes y compris dans les détails à l’exécutif gouvernemental sur ses actes et décisions (ici, c’était la fonction de contrôle et non pas de production législative) ; la capacité des députés de voter « en conscience », c’est-à-dire de voter le cas échéant contre le gouvernement y compris en étant membre de la majorité. Même dans un pays comme la Grande-Bretagne, où la dépendance de l’exécutif vis-à-vis du Parlement aboutit à des changements de gouvernement moins fréquents, un Premier ministre ne peut être fort que dans la mesure où il impose son leadership de conviction sur sa majorité via son parti politique (parti libéral pour Gladstone, parti conservateur pour Disraeli pour citer les deux Premiers ministres les plus célèbres) : un Premier ministre peut donc être fort, mais il doit écouter sa majorité et accepter de faire des compromis dans le processus de la fabrique des lois. Cette « responsabilité » parlementaire du gouvernement représente le point ultime du parlementarisme : dans une tradition républicaine comme celle qui existe en France, la mise en jeu constante du gouvernement devant la Chambre (et à certains moments devant le Sénat) par ce jeu de votes sur la « question de confiance » est devenu la clef de voûte du régime. Elle représente aussi un ethos de comportement de la part des parlementaires, députés et sénateurs, qui considèrent leur liberté de vote (pensée comme une liberté de conscience et donc de rejet de la logique de discipline due à un parti politique) comme sacrée. Elle représente une philosophie de la politique qui à son point extrême « préfère » le risque de l’instabilité des gouvernements (dont la durée de vie est de moins d’une année sous la Troisième République, de six mois sous la Quatrième République) à celui que le dernier mot ne revienne pas à la « représentation nationale ».
Vers une démocratie exécutive ?
Les choses ont commencé à changer en défaveur du parlementarisme à partir du début du XXe siècle et surtout des années 1930. De plus en plus, les gouvernements prennent en charge la production des décisions publiques de manière directe, par exemple par l’augmentation des décrets et de ce que l’on appelle le pouvoir réglementaire. Dans le cas des décrets-lois, le gouvernement peut même produire des décrets à partir d’une simple loi d’habilitation qui se contente d’annoncer le domaine et le calendrier général des décrets à venir. Cela signifie que le Parlement ne peut plus réellement intervenir sur le contenu des décisions. Les décrets-lois sont utilisés de manière de plus en plus intensive au cours des années 1930. Ils réapparaissent sous une forme nouvelle avec les ordonnances du Gouvernement provisoire présidé par le général de Gaulle (1944-1945), et surtout avec les ordonnances de la Cinquième République. Les politiques économiques notamment imposent le recours aux décrets en raison de l’urgence à agir et de la nécessaire cohérence de toutes les mesures envisagées. Après la Deuxième Guerre mondiale, un certain nombre de secteurs d’intervention de l’État sous la forme moderne des « politiques publiques » échappent de plus en plus au domaine de la loi qui avait fait dans le premier modèle républicain la force du parlementarisme. Ce fut le cas notamment pour l’aménagement du territoire, les politiques industrielles et énergétiques (la politique nucléaire), les politiques publiques de protection sociale dont certaines relèvent de la cogestion entre l’État et les organisations syndicales. Dans ce modèle de la « politique publique », le passage par le vote d’une ou plusieurs lois s’impose encore assez souvent. Mais la loi votée au Parlement se contente de fixer un cadre assez général et ne contient plus forcément la réalité concrète de la décision publique. Le fait qu’une loi votée par le Parlement (ou du moins certains articles d’une loi) peut être invalidée par une décision du Conseil constitutionnel s’ajoute au processus général de relégation du Parlement, même si le « coup » porté ainsi par le Conseil constitutionnel touche aussi l’exécutif qui est le plus souvent à l’initiative de la loi. On ne peut plus dire aujourd’hui, comme on le faisait à l’époque du parlementarisme dominant, que l’Assemblée ou que la « représentation nationale » a toujours le dernier mot. La souveraineté du Parlement est devenue une chose du passé.

Hémicycle de l’Assemblée nationale lors du vote d’une loi en 2009. (c) Richard Ying et Tangui Morlier
À ces aspects institutionnels et juridiques s’ajoutent d’importants éléments politiques. Sous la Cinquième République, les parlementaires sont de plus en plus amenés à respecter la discipline de leur groupe, notamment quand ils appartiennent au groupe majoritaire ou à l’un des groupes membres d’une majorité de coalition. L’apparition de ce « fait majoritaire » à partir des années 1960 peut être vue comme un facteur positif pour le Parlement qui fonctionne de manière plus efficace et peut plus facilement s’adapter à des besoins d’urgence (par exemple dans le vote de la législation liée à la crise sanitaire de la COVID). Le fait majoritaire renforce cependant la force du gouvernement plutôt que la capacité de débattre des assemblées. Si le mécanisme de responsabilité du gouvernement devant l’Assemblée existe toujours, il ne revêt plus le même sens qu’à l’époque du parlementarisme : il est devenu un moyen de contrôle et de leadership pour le Premier ministre (et indirectement pour le Président de la République hors période de cohabitation) s’imposant à sa majorité. Le nouveau parlementarisme ne présente plus le risque d’un renversement du gouvernement (ce n’est arrivé qu’une fois sous la Cinquième République avec le vote d’une motion de censure contre le gouvernement Pompidou, en octobre 1962), il participe en cela à la stabilité et à la continuité de l’exécutif, mais il ne garantit plus la capacité pour le Parlement de modifier de manière sensible et constructive les textes législatifs préparés par le gouvernement. Le sens du parlementarisme s’est ainsi quasiment inversé : ce n’est pas à l’exécutif de prouver qu’il applique de manière respectueuse et fidèle les contenus des lois votées au Parlement, organe d’expression de la « volonté » du peuple, mais à l’Assemblée de prouver qu’elle est capable de soutenir l’exécutif sur la durée et lui permettre de « gouverner », notamment de faire voter dans un temps court et sans grande modification les projets législatifs qu’il a préparés. Autrement dit, le Parlement qui avait été le cœur d’une conception de la démocratie comme démocratie de délibération en assemblée est devenu l’auxiliaire d’une démocratie que l’on peut qualifier maintenant de démocratie exécutive.
Cette évolution assez défavorable au Parlement ne signifie pas cependant son abaissement complet. Dans ce nouveau cadre dominé par les exigences de l’exécutif, le Parlement conserve un certain nombre d’atouts. Il peut tout d’abord développer la fonction nouvelle d’évaluation des politiques publiques notamment à travers le travail des commissions, celui de missions d’informations et par le truchement d’auditions publiques liées à des enquêtes qui peuvent porter sur des dysfonctionnements de l’exécutif. La création du Comité d’évaluation et de contrôle (CEC) en 2009 a marqué un certain progrès de ce point de vue. Si les grandes joutes parlementaires appartiennent au passé, l’esprit du parlementarisme demeure cependant actif à travers le rôle des parlementaires qui sont les seuls élus à pouvoir faire le lien entre le local et le national, entre leur circonscription et l’Assemblée à Paris, entre des réunions de « comptes rendus de mandat » organisées dans leur circonscription et ce qu’ils peuvent en rapporter pour en informer leurs collègues ou les membres de l’exécutif.
Ce que l’on peut appeler l’ethos du parlementarisme n’est donc pas perdu : il continue d’entretenir dans la société française l’idée des débats nécessaires, la nécessité de l’expression des citoyens du local vers le national, et de la construction des compromis.
Si la porte de la modernisation du Parlement est donc loin d’être fermée, il n’en reste pas moins que le parlementarisme d’aujourd’hui n’a que peu de ressemblances avec l’âge d’or que l’on peut situer entre les années 1880 et le début des années 1930. Peu d’écrivains ou de figures de proue du monde littéraire et intellectuel se lancent aujourd’hui dans une carrière de parlementaire. La tradition des Lamartine, Hugo, Guizot, Thiers ou Tocqueville est derrière nous. L’idée comme la forme « Parlement » conservent cependant de leur prestige comme en témoigne, à chaque fois que l’on veut « réinventer » la démocratie ou que l’on veut en étendre les limites, le recours à un « Parlement ». Qu’il s’agisse du « Parlement des enfants », de la vogue des concours d’éloquence dans le monde étudiant ou bien, au cœur même de la politique la plus récente, l’organisation de débats citoyens ou de conventions citoyennes (la Convention citoyenne pour le climat créée en octobre 2019). En profondeur donc, l’idée de Parlement demeure fortement liée aux valeurs de la démocratie moderne. •
Pour en savoir plus :
Denis Baranger, Parlementarisme des origines. Essai sur les conditions de formation d’un exécutif responsable en Angleterre, Presses universitaires de France, 1999.
Jean Garrigues (dir.), Histoire du Parlement de 1789 à nos jours, Armand Colin, 2007.
Alain Laquièze, Les origines du régime parlementaire en France, 1814-1848, Presses universitaires de France, 2002.
Revue Parlement[s]
Nicolas Roussellier, Le Parlement de l’éloquence, Presses de Sciences Po, 1997 ; La Force de gouverner. Le pouvoir exécutif en France, XIXe-XXIe siècles, Gallimard, 2015.
Olivier Rozenberg et Éric Thiers (dir.), Traité d’études parlementaires, Bruylant, 2018.