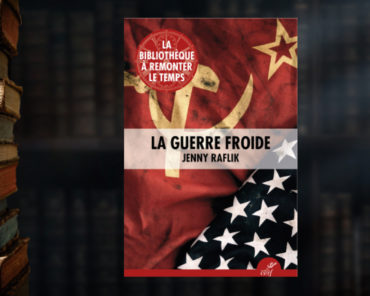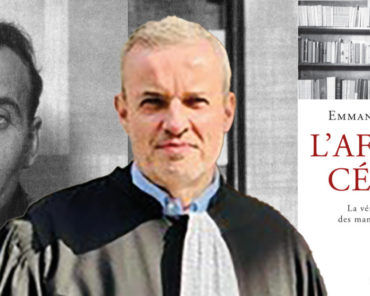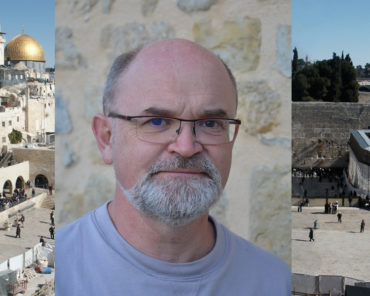Article publié dans Histoire Magazine N°11
Abondamment cité, rarement lu, Paris et le désert français fait partie de ces ouvrages célèbres et méconnus à revisiter avec profit. Un titre sonnant comme les cloches annonciatrices d’un danger, une idée aussi forte que simple — la France se meurt de la centralisation parisienne — constituent deux ingrédients de son succès. D’autant que le moment où paraît l’ouvrage, l’année 1947, n’est pas anodin : alors que l’Est et l’Ouest entrent en Guerre froide, la France tente de se relever des décombres du second conflit mondial, espérant se doter d’un régime plus stable que celui de la IIIe république défunte.
Issu de réflexions menées durant l’entre-deux-guerres et poursuivies sous Vichy, l’auteur a pour objet de projeter son pays dans l’avenir, de le « moderniser ». D’où ce mélange de traits anciens et nouveaux que l’on peut aujourd’hui, après coup, relever dans son livre. La France y est perçue comme un organisme vivant ayant besoin, pour se développer harmonieusement, d’établir un équilibre entre ses différentes parties — métropoles et villes secondaires, régions, villes et campagnes. Raoul Dautry, ministre de la Reconstruction et de l’Urbanisme (1944-1946) le dit dans sa préface : il faut « une répartition mesurée et une judicieuse dispersion des activités ». Pour cela, chez Gravier, la démographie est première : il importe de trouver une sorte de densité idéale et, pour ce faire, de mobiliser les ressources de la toute nouvelle planification à la française. On la sait indicative et moins impérative que la soviétique. Cela n’empêche pas Gravier de décocher ses flèches les plus acérées en direction d’un libéralisme économique perçu comme destructeur dès lors qu’il n’est pas contrôlé.
Tout est prévu dans ce livre. L’analyste, le démographe, le statisticien, s’invitent à toutes les échelles, du pays à la commune, en passant par les régions. L’auteur y indique comment favoriser ici l’implantation d’usines, créer là une université de taille régionale. Comment impulser des déplacements sectoriels (trop de cabaretiers, pas assez d’ouvriers spécialisés dit-il en substance) ? Comment, aussi, favoriser une immigration de main-d’œuvre choisie et maîtrisée de manière à ce qu’elle s’assimile véritablement ? Pour tout cela, dit Gravier, les hommes qui nous gouvernent doivent prévoir, associer projets à long et à court terme, user de pédagogie, établir des sortes de points d’étapes pour leurs concitoyens. Il faut, aussi, qu’ils disposent d’une relative stabilité ; cinq ans, écrit l’auteur. Regrettant en filigrane le régime d’assemblée qui se profile déjà en 1947, il anticipe sur notre Ve République et son quinquennat. Gravier tente de relier le passé à l’avenir. Mais il est pétri des présupposés et contradictions liés à son époque et à son itinéraire. Aussi ne peut-il qu’osciller entre ces deux temporalités, en fonction des thèmes abordés. Raison pour laquelle le relire permet tout à la fois de comprendre une époque et de décrypter une partie de notre présent.
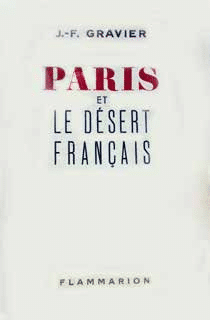
Gravier, n’invente pas l’idée de décentralisation. Le mot apparaît en 1829 et le principe est débattu durant tout le XIXe siècle. Il n’innove pas davantage du côté de la méthode. À la fin du XVIIIe siècle, déjà, se fait jour l’idée d’une refonte de la carte administrative du territoire, d’une réforme « d’en haut », pensée par des « experts ». La vraie nouveauté réside dans le changement de paradigme, dans le passage du laisser-faire à ce que l’on appellera bientôt la politique d’aménagement du territoire. Gravier la pense au service de la production. Mais il en perçoit aussi le caractère redistributif en termes, sinon de justice, du moins d’équilibre social.
Le mouvement se renforce durant les décennies suivantes, à la fois d’en haut et d’en bas (pensons au Comité d’étude et de liaison des intérêts bretons, le fameux CELIB, lancé en 1950, autour de René Pleven). Pour Gravier, l’État stratège, l’État arbitre, doit jouer le rôle principal. L’empilement des strates et la constitution de notre millefeuille territorial font que l’on ne sait plus guère, aujourd’hui, à qui a échu cette fonction. Ni même si elle est véritablement mise en œuvre quelque part. Mais la géographie française s’est profondément transformée depuis les années 1950. Le géographe, aujourd’hui, s’intéresse d’abord, et presque essentiellement, aux territoires et à leur aménagement. C’est ce passage, de l’idée de décentralisation à celle d’aménagement du territoire, que sous-tend et annonce Paris et le désert français. L’ouvrage en constitue aujourd’hui une incontournable butte-témoin.•
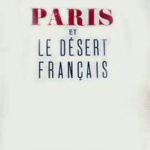
PARIS et le désert français
par Jean-François Gravier. Préface de Raoul Dautry
éditions Flammarion 314 pages.