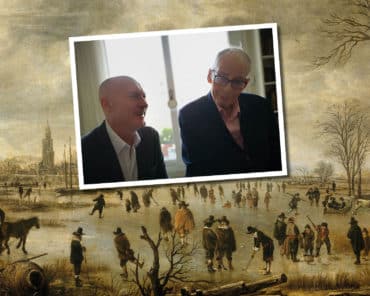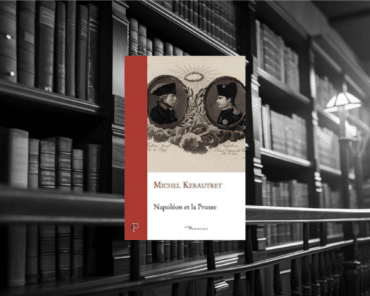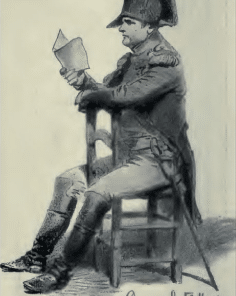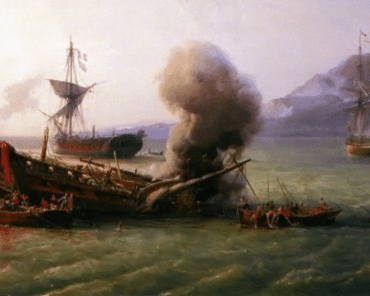Très tôt dans sa vie, Bonaparte comprend la nécessité de maîtriser son image, voire de la modeler pour servir ses intérêts …
Jean Tulard : C’est le propre des grands conquérants et César l’a fait le premier par ses écrits-, de savoir bâtir
sa légende. Bonaparte jeune a lu César, a suivi la carrière d’Alexandre, et d’emblée, dès la première campagne d’Italie, il comprend qu’il faut glorifier ses victoires. La victoire de Lodi, la victoire d’Arcole, ce sont de petites batailles. On va leur donner une très grande ampleur en créant des journaux, comme « le journal de Bonaparte et des hommes vertueux », « le journal de l’Armée d’Italie » et ces journaux relatent les campagnes d’Italie, ils sont à la gloire de Bonaparte et sont diffusés en France, au même titre que les autres journaux, mais ils sont subventionnés par l’argent que l’armée d’Italie pille dans les caisses des Italiens. Leur style est très révélateur, on y trouve par exemple : « Bonaparte vole comme l’éclair et frappe comme la foudre ». C’est lui-même qui écrit cela de lui et c’est répercuté partout ! En sorte que sous le Directoire, alors que les directeurs sont des gens âgés et cor- rompus, on voit se profiler en Italie un jeune général, séduisant, qui remporte des victoires éclatantes. C’est comme cela que l’on créée le personnage de Bonaparte et que la campagne d’Italie a été éclatée et le reste encore aujourd’hui.
Ainsi Bonaparte tranche sur les autres généraux : Pichegru s’empare de la flotte hollandaise avec ses hussards, mais il ne sait pas exploiter cet évènement extraordinaire. Moreau également remporte des victoires, mais il ne sait pas les exploiter. Bonaparte apparaît comme le meilleur général en utilisant ainsi la presse, en utilisant aussi l’image. Ce sont ces images que l’on connaît du général Bonaparte au pont d’Arcole, jeune, les cheveux au vent, très romantique. L’image joue un rôle là encore important du jeune général vertueux par rapport à la corruption du Directoire, et victorieux alors que les autres généraux finissent par essuyer des défaites, puisque c’est l’armée d’Italie qui se couvre de gloire et que l’armée du Rhin elle va être battue.
Est-ce à dire qu’il se pressentait un destin ou était- ce une stratégie pour servir ses intérêts immédiats ?
Jean Tulard : Il y a d’une part une stratégie politique. Il sait que la Révolution, enlisée depuis le début, sera terminée par un général victorieux. C’est ce qui est arrivé pour la révolution anglaise avec Monck, et il sera le nouveau Monck. Il sait désormais que c’est lui, puisque les autres ont échoué, Dumouriez, La Fayette, qui va être le général qui finira la Révolution. Il le dit après la victoire de Lodi. Il fait une confidence qui est rapportée « A partir de la victoire de Lodi je me sentis avoir un grand destin à l’horizon ».
La Fayette a cru un moment donné qu’il avait ce grand destin. Mais La Fayette est venu trop tôt, la Révolution ne faisait que commencer. Dumouriez, vainqueur de Valmy, a cru aussi qu’il allait renverser la situation, l’un et l’autre pensant devenir maire du palais en restaurant la monarchie, et puis les événements se sont aggravés. Pichegru aussi a cru qu’il pourrait restaurer le roi. Ils ont tous échoué parce qu’ils n’étaient pas là au bon moment. Bonaparte arrive alors que la Révolution est à bout de souffle et que le Directoire est complètement discrédité. La restauration de la monarchie paraît difficile. Il y a là le moment où un grand destin peut s’épanouir.
Toute sa carrière, il aura été soucieux de préserver son image, de la fabriquer, de la contrôler …
Jean Tulard : Après le coup d’État de brumaire, il va créer la légende de l’homme qui a une puissance de travail extraordinaire. C’est l’homme qui peut passer 15 heures à son bureau d’affilée en traitant plusieurs affaires. C’es l’homme qui a réorganisé la France. La propagande joue
énormément dans ce domaine. Et puis il y a le militaire. Il va se composer, et c’est là sa grande force, une image. C’est l’homme qui a un petit chapeau, une redingote grise et qui a la main dans son gilet. Il comprend le premier que si l’on veut créer un personnage, il faut en donner une image qui frappe. Ce chapeau, la redingote, la position avec la main dans le gilet, c’est voulu, c’est composé pour que sur un champ de bataille quand les soldats voient la silhouette du petit chapeau et de la redingote grise, ils se disent «
Ah, Napoléon est là, on va gagner ! On est sûr, il est sur le champ de bataille ». D’autre part, il y a également, ce qui est extrêmement frappant, le fait que cette image est reproduite dans les imageries d’Epinal. Et aujourd’hui encore, n’importe quel acteur peut interpréter le rôle de Napoléon,
même Christian Clavier qui ressemble à Napoléon comme je ressemble à César, il suffit d’avoir le petit chapeau et la redingote, et aussitôt on se dit : « c’est Napoléon ». Il crée donc un personnage, et une image qui va s’imposer partout, et voyez qu’un des chapeaux de Napoléon s’est vendu plus d’un million à un admirateur sud-coréen. La légende naît avec la campagne d’Italie et elle s’affirme quand il est au pouvoir à travers l’exaltation de ses qualités de travailleur, à travers une silhouette, la presse qu’il contrôle et toujours les bulletins de la Grande Armée qui racontent les batailles de Napoléon officiellement, et qui les racontent à l’avantage de Napoléon. Les bulletins de la Grande Armée sont les premiers communiqués de guerre, ce sont eux qui exaltent ses victoires. Il ne suffit pas d’être victorieux, il faut encore qu’on le sache et qu’on exalte ses victoires.
Napoléon lui-même avait conscience que cette propagande (impériale) allait modeler l’Histoire …
Jean Tulard : Il s’arrange précisément pour que l’histoire corresponde aux bulletins de la grande Armée. Ils sont réunis pour donner l’histoire militaire de l’Empire et lui-même ensuite, à Sainte-Hélène, dans le Mémorial et dans les dictées de Sainte-Hélène raconte son histoire et l’impose. Il comprend très bien le rôle de la postérité. Il y a la propagande immédiate et il y a l’avenir. Lorsqu’il est au pouvoir, la presse est maîtrisée, les bulletins, l’imagerie sont mis en œuvre et lorsqu’il perd le pouvoir, et qu’il est à Sainte-Hélène, il travaille la postérité.
Même après sa mort, on a poursuivi l’œuvre d’édification de sa légende, sa légende noire, et sa légende dorée …
Jean Tulard : J’ai écrit un petit livre publié chez Gallimard, l’Anti- Napoléon, dans lequel j’ai recensé tous les pamphlets écrits contre Napoléon à partir de 1814, lorsqu’il perd le pouvoir. Il y a deux écrivains immenses qui ont créé cette légende noire : Chateaubriand avec « De Buonaparte et
des Bourbons » et Benjamin Constant avec « De l’esprit de conquête et de l’usurpation ». Ce sont eux les pères d’une légende noire, représentant un courant libéral avec Constant et ultra royaliste avec Chateaubriand. Cette légende noire a failli triompher et c’est contre cette légende noire qu’est écrit le Mémorial de Sainte-Hélène publié en 1823, qui lui, refait basculer Napoléon dans la légende dorée et la légende noire est anéantie, provisoirement du moins.
Sous le Second Empire, Napoléon III entreprend de publier la correspondance de Napoléon 1er, qui est considérable, et là encore avec le souci d’expurger de la publication tout ce qui ne cadre pas avec l’image…
Jean Tulard : Vous avez parfaitement raison. Beaucoup de lettres vont être écartées, on a fait beaucoup de coupures. A un moment donné, Napoléon donne l’ordre de torturer, il s’agit de Cadoudal, bien que la torture soit abolie depuis Louis XVI. On va écarter aussi des jugements trop abrupts sur certaines personnes. La première édition de la correspondance a été très trafiquée, on y avait même introduit des fausses lettres. Il a fallu attendre la Fondation Napoléon et Thierry Lentz pour que l’on ait une édition de la correspondance exacte en fonction des originaux et dans un esprit objectif.
Napoléon III reprend cette légende tout en étant un peu réservé parce que lui-même n’est pas le descendant direct de Napoléon.
On le soupçonne de n’être pas tout à fait de la famille. Il y a ce mot fameux de Napoléon III quand on lui dit : « vous n’avez rien de Napoléon » et lui répond : « Oh si, j’ai sa famille ». Napoléon III rétablit, à partir du Mémorial, cette légende dorée et cette légende dorée s’écroule de nouveau pour laisser place à la légende noire avec les défaites de 1870.
Après 1870, avec Zola « La débâcle » et avec Victor Hugo « Les châtiments », renaît une légende noire qui ne va pas durer très longtemps. Nous sommes sous la Troisième République dont la grande idée est la revanche. Nous avons perdu en 1870 l’Alsace et la Lorraine et il faut les reprendre. On cherche comment y parvenir militairement et on découvre que le seul général qui ait vraiment vaincu les Prussiens, c’était Napoléon à Iéna. Napoléon est redécouvert comme celui qui peut nous donner des enseignements pour reprendre l’Alsace et la Lorraine et c’est Barrès dans « Les Déracinés » qui va monter cette légende. Rappelez- vous ces jeunes gens qui foncent devant le tombeau de Napoléon pour prendre des leçons d’énergie. La légende dorée repart à nouveau après un bref épisode de légende noire. Foch et Joffre vont se réclamer de Napoléon et cette légende va arriver jusqu’à nos jours.
Récemment, l’image de Napoléon a été attaquée, et cela pour un motif surprenant au regard de ses convictions personnelles…
Jean Tulard : Alors même que 1968 est passé sans remise en cause de Napoléon, la légende noire semble reprendre un peu du poil de la bête avec la question du rétablissement de l’esclavage en 1802 par Napoléon. On a vu Jacques Chirac refuser de célébrer Austerlitz.
Il y a à nouveau une légende noire tout à fait injuste sur ce problème de l’esclavage. Napoléon s’est formé par Rousseau qu’il exalte et qui n’est pas un esclavagiste, formé par l’Abbé Raynal à qui il dédie son discours de Lyon qui condamne l’esclavage. Lui-même lorsqu’il arrive au pouvoir dit :« nous ne rétablirons pas l’esclavage » dans ses premières déclarations. L’esclavage avait été aboli seulement en 1794 par la Convention bien que la Déclaration des droits de l’Homme « les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits » date de 1789. Napoléon n’avait pas l’intention de rétablir l’esclavage. En 1802, à la paix d’Amiens, les Anglais nous ont restitué la Martinique où on n’avait pas aboli l’esclavage. On avait de l’autre côté la Guadeloupe où l’esclavage avait été aboli. Le Sénat a donc cherché une solution et on a rétabli l’esclavage en Guadeloupe et à Saint Domingue pour faire redémarrer les plantations et, je n’ai pas de documents l’attestant, mais il semble évident que c’était dans l’idée qu’il s’agissait d’une solution provisoire. Et d’ailleurs en 1815, peut-être pour séduire les Anglais, Napoléon abolit la traite.
Lorsque Bonaparte rétablit l’esclavage en 1802, cela n’a rien de choquant, il faut remettre cet événement historique dans son contexte. Washington, modèle de démocratie, a des esclaves. Les Anglais, les Russes ont des esclaves. Tous les pays européens ont dans leurs colonies des esclaves. Les barbaresques ont des esclaves chrétiens. A l’époque, personne n’est choqué. Il n’y a guère que la classe des sciences morales et politiques de l’Institut qui a protesté. D’ailleurs, elle sera supprimée en 1803, mais en raison du Concordat.