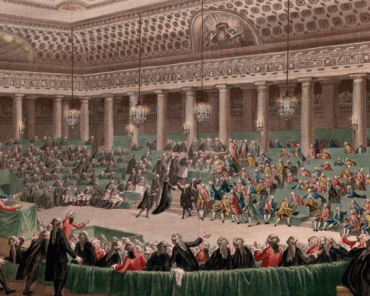« Le général de Gaulle est loin d’avoir joué un rôle majeur dans cette réforme »
Article publié dans Histoire Magazine N°11
Après 70 ans de pratique, quand on évoque le droit de vote des femmes, il est difficile d’imaginer que ce droit était loin d’être naturel, et rétrospectivement, on est confronté à des clichés persistants qui nient le rôle et le long combat des femmes qu’elles durent mener pour faire bouger les lignes…
Anne-Sarah Moalic Ces clichés sont bien souvent portés par les historiens eux-mêmes, qui balaient d’un revers de manche cette longue lutte. Ils préfèrent s’en tenir à ces clichés, notamment celui expliquant que les femmes auraient voté « pour les curés », reprenant en cela la rhétorique de quelques antisuffragistes du premier 20e siècle. Que les femmes soient des objets historiques leur a longtemps échappé (d’où la nécessité d’une « histoire des femmes », portée par des pionnières comme Michèle Perrot), alors en faire des actrices de l’Histoire…
À la fin du XVIIIe siècle, de nombreuses femmes font entendre des revendications d’égalité entre les hommes et les femmes, dont on trouve trace dans les cahiers de doléance, mais la Convention, en 1793, y met un terme. On pense bien évidemment à Olympe de Gouges qui devient un personnage emblématique de ces revendications…
Il aura fallu attendre le 21e siècle pour qu’Olympe de Gouges devienne une sorte de star de la Révolution… Cela oblige à constater le manque de figure féminine historique dans cette histoire de la Révolution. Passées Olympe de Gouge et Charlotte Corday, on arrive directement aux « Tricoteuses », ces femmes qui assistaient aux procès en tricotant, et qu’on a accusées de se réjouir des condamnations à mort.
Je ne sais pas si tant de femmes réclamaient réellement l’égalité. Peut-être celles qui avaient des biens et se voyaient dépossédées de leur usage… Au-delà de la figure parfois fantasque d’Olympe de Gouge, il ne faut pas négliger le rôle majeur, à cette époque, du philosophe Nicolas de Condorcet, qui, en homme des Lumières, argumente avec finesse sur la question de l’égalité entre les êtres. Ce sont des textes d’une grande modernité.
En 1848, on évoque la possible candidature de la célèbre George Sand, mais cette dernière s’oppose à cette idée. N’était-ce pourtant pas là une occasion à saisir à la suite de l’adoption du suffrage universel qui constituait déjà en soi une petite révolution ?
Il y a là une question de psychologie, mais aussi d’air du temps.

Georges SAND. Dessin au fusain vers 1850
La manière dont George Sand a décliné la proposition d’être candidate a été extrêmement méprisante par rapport aux femmes qui portaient cette idée.
On peut y voir la volonté de rester la seule de son espèce, au-dessus des autres, ce qui pouvait satisfaire son ego. Mais c’est aussi symptomatique de l’état de l’opinion publique. George Sand militait pour l’amélioration de la condition féminine, mais son combat s’arrête aux portes du pouvoir, du droit de vote. Pourquoi ? Le vote des femmes était vraiment considéré comme une utopie, une utopie socialiste, qui plus est. George Sand ne voulait sans doute pas prendre sa part de ridicule et être stigmatisée.
Par ailleurs, en effet, le suffrage universel était une grande révolution. Soudain, on brisait la hiérarchie sociale entre les indigents et les riches, les roturiers et les nobles. C’est véritablement la fin d’un privilège. Beaucoup, à gauche, notamment, se méfiaient du suffrage universel et auraient préféré qu’on éduque davantage le peuple avant de lui laisser les mains libres. Cela explique aussi sans doute en partie la réticence à accroître encore ce corps électoral en y ajoutant les femmes. Et les suites de ce premier suffrage universel — l’élection de Louis-Napoléon Bonaparte et son coup d’État ne vont probablement pas favoriser l’extension de ce corps électoral, même des dizaines d’années plus tard.

Les femmes socialistes. Caricature de DAUMIER
La IIe République verra tout de même la candidature d’une femme pour l’élection législative, Jeanne Deroin…
Jeanne Deroin, c’est l’une de mes héroïnes. L’une des grandes pionnières du vote des femmes et du militantisme féminin en France.
Après avoir organisé un journal et une association pour les droits des femmes, elle décide de se lancer dans le combat législatif, en 1849. C’est une première. Pour mesurer l’audace et le courage, il faut se replacer dans l’époque : se présenter comme candidate socialiste, à une époque où le socialisme est un parti très marginal, très à gauche, c’est déjà prendre un risque. C’est aussi l’une des premières élections au suffrage universel. Il fallait oser s’y projeter comme candidat. Et puis enfin, surtout, se présenter en tant que femme… occuper le devant de la scène, faire acte d’indépendance, faire de la politique : autant d’incursions dans un monde masculin. Jeanne Deroin a été beaucoup moquée et caricaturée. Elle a aussi reçu, parfois, un bon accueil lors des meetings qu’elle a tenus. Elle a laissé un récit extrêmement touchant de sa campagne politique (consultable sur Gallica).
Dans les années 1870, la guerre, les événements de la Commune de Paris, et l’installation de la République sont à l’origine d’une régression des idées féministes. Comment l’expliquez-vous ?
C’est tout à fait exact. C’est à ce moment que le terme « féminisme » apparaît, et pas pour en dire du bien. On crée l’image de la Pétroleuse, qui aurait incendié Paris. C’est une manière de dire que les femmes qui s’impliquent dans la vie politique du pays se changent en furie, qu’elles ne peuvent que faire du mal. Alexandre Dumas fils n’est pas le dernier à contribuer à cette relecture de l’histoire, lui qui qualifie les femmes de la Commune de « femelles », entre autres. Dans ces premières années de la 3e République, le backlash antiféministe est patent. À mes yeux, en réponse aux troubles que vous évoquez, à la nouveauté du régime, la société se rassure en resserrant ses fondations : la famille, et donc les relations femmes-hommes. Le conservatisme se pare de républicanisme, mais il n’en reste pas moins contraignant, en particulier pour les femmes. Il suffit de relire quelques figures tutélaires de la 3e République, comme Jules Michelet, pour s’en convaincre.
« Il faut malgré tout nuancer cette idée d’une régression : la fin du Second Empire permet aussi la libération d’une certaine parole féministe qui ne disparaît pas avec la guerre de 70… »
À cette même époque apparaît une femme, Hubertine Auclert, la pionnière des suffragistes, et quelques autres candidates, tournées en dérision par la presse…
Hubertine Auclert arrive sur un terrain qui a déjà été défriché. Maria Deraismes, André Léo, Julie Victoire Daubié, et tant d’autres ont parlé de la condition des femmes depuis plusieurs années déjà. Elles se battent pour l’éducation des femmes, pour la reconnaissance de leur travail, pour leurs droits civils. C’est ce dernier mouvement qu’Hubertine Auclert rejoint, quand elle monte à Paris vers 1876. Assez vite, elle milite pour la primauté des droits politiques sur les droits civils. Pour elle, aucune amélioration conséquente de la condition féminine n’aura lieu tant que les femmes ne seront pas représentées et qu’elles n’auront aucun poids politique. Elle fait peu à peu sa place, gagne une certaine audience, plutôt sérieuse, d’ailleurs. Et elle met en place des campagnes que les activistes du 21e siècle ne pourraient pas renier. Elle décide notamment de pousser des femmes à se présenter aux élections, à partir des années 1880. Elle n’est pas seule à le faire et n’est pas forcément moteur — je pense à des militantes comme Louise Barberousse, très actives pour défendre cette idée des candidatures féminines. En effet, la presse s’en délecte. Il y a, là aussi, un vrai courage à se mettre ainsi en avant, pour donner un coup de projecteur à la cause.
Quel regard porte-t-on alors sur les mouvements de suffragettes anglo-saxons ?
Jusqu’aux années 1910, le mouvement anglo-saxon est, certes, beaucoup plus poussé qu’en France, mais le combat se joue avec les mêmes armes. Le côté « suffragette », c’est-à-dire des actions militantes en dehors des lois, n’arrive qu’après. Je n’ai pas observé de comparaisons très fournies entre les pays, même si des mouvements internationaux se mettent en place au début du 20e siècle, et que les exemples étrangers comptent.
À partir de 1896, la sociologie de ces mouvements pour les droits des femmes évolue, et avec elle leur dédiabolisation commence…
Cet aspect sociologique est en effet primordial ! Lorsque des femmes de la haute bourgeoisie, proches des gouvernants, s’impliquent pour le vote, les choses se mettent à bouger. À l’origine, leur réflexion est portée par la philanthropie et le rôle des femmes dans la lutte contre les fléaux sociaux. On pense que les femmes sont un véritable levier de transformation sociale et doivent donc pouvoir peser, au moins au niveau local, dans les décisions. On a ainsi un mouvement en ciseau :
…d’un côté, des militantes de longue date, plutôt étiquetées à gauche, ouvrières ou petites-bourgeoises, qui rencontrent, d’un autre côté, la haute bourgeoisie. Et ces dernières rendent la cause respectable.
Cela change tout et va permettre au fur et à mesure de convaincre tout le spectre de l’opinion publique qui les sépare.
Un moment clé de cette dédiabolisation se passe lors d’un grand congrès, en 1900, où des titres de presse reprennent avec soulagement la déclaration de l’une des leaders du mouvement suffragiste, affirmant la qualité de ses confitures, sous-entendu : avoir un engagement public n’empêche pas d’être une bonne ménagère, épouse et mère…
Le début du XXe siècle voit la multiplication de débats parlementaires sur le suffrage féminin, sans que cela aboutisse. Et pourtant la Première Guerre mondiale a entraîné des changements profonds en Europe, de plus en plus de pays accordent aux femmes des droits politiques plus ou moins étendus…
Ce sont essentiellement des changements politiques. L’éclatement des empires a donné naissance à de nombreux pays, qui ont dû rédiger leurs constitutions. Or il y a à cette époque une meilleure reconnaissance de la place des femmes dans la société : elles sont plus éduquées, elles travaillent, et cela se voit — encore plus avec la guerre. Les nouvelles constitutions accordent généralement aux femmes des droits politiques plus ou moins étendus. Au Royaume-Uni, la constitution change aussi pour mettre en place le suffrage universel. On y donne aux femmes de plus de 30 ans le droit de vote…
Quant à la France, elle ne change pas de constitution. Mais les députés votent malgré tout en faveur du suffrage des Françaises en mai 1919, avec une vraie majorité. Le Sénat va ensuite bloquer cette réforme pendant des années.
Le Sénat semble de plus en plus seul dans sa résistance à la réforme…
Le Sénat freine autant qu’il peut. Son inertie est immense. Il va voter deux fois contre le vote des femmes, en vingt ans, là où la Chambre des députés votent en faveur du texte à de multiples reprises.
Si le Sénat, au début des années 20, n’est pas seul à résister à la réforme, à la fin de cette décennie, l’opinion publique a définitivement basculé, et la presse avec elle. Le Sénat semble en retard sur son temps, mais c’est aussi l’argument principal des sénateurs : ils se positionnent dans le temps long et reprochent aux députés de suivre les émotions des foules. Ils se voient comme les garants de la République et de ses valeurs premières, qui évidemment n’incluaient pas les femmes. Ils sont, en quelque sorte, restés figés sur les grandes premières heures de la 3e République.
On pourrait penser a priori que la gauche progressiste aurait été plus favorable au droit de vote des femmes qu’une droite conservatrice, mais dans les faits, ce n’est pas exact…
Les lignes de clivage sont en effet assez particulières. Il y a une gauche progressiste sur de nombreux sujets, mais pas sur celui des femmes, une gauche progressiste qui veut aussi faire avancer les droits des femmes, une droite conservatrice qui verrait bien les femmes électrices… Il existe des suffragistes catholiques depuis le début du 20e siècle ! Chacun y arrive via sa propre vision du monde.
Si Maurice Barrès devient favorable au vote des femmes après la Première Guerre, ce n’est pas par féminisme, c’est qu’il soutenait l’idée d’un « vote des morts », où les épouses, mères, sœurs, etc. auraient voté pour les soldats morts au combat.
Il y a donc à la fois le jeu politique classique, mais aussi des prises de position personnelles…
Dans les années 30, le progrès va venir des collectivités territoriales, mais aussi de Léon Blum qui nomme trois femmes sous-secrétaires d’État dans son cabinet. Pour autant, est-ce utile au suffragisme ?
Bien sûr ! Il fallait faire feu de tout bois pour débloquer la situation. Les premières femmes élues sont des communistes, portées en tête de liste par leur parti, en 1925. Puis il y a plusieurs expériences, à travers la France : des villes où l’on organise des élections pour des conseillères municipales officieuses, parfois en invitant les femmes à voter, comme à Villeurbanne, Dax ou Louviers. Et un grand nombre de villes et villages où l’on nomme ces conseillères, pour faire gagner le conseil municipal en représentativité, pour répondre à la demande sociétale, aussi. Tout cela se fait en parallèle de la nomination des trois sous-secrétaires d’État en 1936, juste après un ultime vote à la Chambre des députés, unanime (un cas très rare) en faveur du suffrage féminin. Tout cela ne pouvait qu’être utile, pour pousser encore et encore le Sénat dans ses retranchements, pour montrer l’union populaire autour de ce sujet. Pour les historiens, cela devrait aussi remettre en question cette idée d’un « retard français ».
Le régime de Vichy va promulguer un texte de loi le 16 novembre 1940 autorisant les femmes à sièger aux conseils municipaux et mène différentes réflexions sur le vote des femmes, cependant ce n’est pas par féminisme…
Non, clairement pas. Le régime de Vichy a très vite renvoyé les femmes qui travaillaient dans leur foyer, tout en leur faisant porter en partie la responsabilité de la défaite. Vichy, c’est le retour de « l’éternel féminin », un grand conservatisme. Mais c’est malgré tout un régime qui doit s’adapter à son époque et à sa population. Comme on l’a vu après la Première guerre, les nombreux pays qui modifient leur constitution intègrent des droits politiques féminins. Le même processus est à l’œuvre dans les tentatives de rédaction de nouvelles institutions vichystes. Pour les conseils municipaux, on voit surtout le retour du corporatisme : chaque conseiller devait représenter un groupe, et la famille, dans ce régime conservateur, reprenait une place très importante. D’où la présence de mères de famille, par exemple, dans ces conseils.
On voit souvent dans les livres d’histoire que c’est le général de Gaulle qui a octroyé le droit de vote aux Françaises. Qu’en est-il précisément ?
C’est l’un des grands clichés de l’histoire du vote des femmes. Le général de Gaulle incarne la libération de la France, et on lui attribue beaucoup de choses. Il n’y était sans doute pas opposé, mais il est loin d’avoir joué un rôle majeur dans cette réforme. C’est passer bien vite sur des éléments majeurs. D’une part, comme on l’a vu au début de cet entretien, les femmes ont été actrices de leur histoire. C’est un peu rapide de dire qu’il aurait fallu attendre un homme providentiel pour résoudre la question. N’oublions pas les cent ans de débats qui ont précédé cette décision et la transformation de la société et de l’opinion publique qui l’ont rendu possible. D’autre part, il y a eu un vrai processus démocratique à l’œuvre dans cette réforme, avec notamment des débats en commission et en séances plénières de l’Assemblée provisoire d’Alger. Et les débats ont été rudes. Ce n’était (toujours) pas gagné d’avance. Il faut donc rappeler le travail de ces députés, notamment de Fernand Grenier, dont la ténacité ont permis le changement. Rappelons aussi que le vote des femmes ne figurait pas dans le projet du comité national de la résistance. Au final, le général de Gaulle ne pouvait pas s’opposer au vote des femmes, et il ne l’a pas fait. Cela reste un peu particulier de lui accorder le crédit de cette réforme. •
Propos recueillis par Sylvie Dutot
Anne-Sarah Bouglé Moalic est docteure en histoire de l’université de Caen-Normandie. Elle a travaillé sur le droit de vote des Françaises et, à travers ce prisme, sur les institutions politiques et sur les féminismes. Elle intervient régulièrement sur ces sujets pour des publics variés (articles dans des revues jeunesse, grand public…).Ses expériences professionnelles lui font explorer d’autres thématiques liées à l’égalité femmes/hommes, comme le monde politique et le monde du travail. Elle publie régulièrement des textes d’opinion dans le quotidien Ouest-France.

La marche des citoyennes Le droit de vote des femmes en France 1870-1944 D’Anne-Sarah Moalic Editions du Cerf Parution : mars 2021. 20 euros