L’anthropologie des religions est infiniment redevable à John Scheid : les travaux qu’il mène depuis plusieurs décennies ont renouvelé en profondeur notre regard sur les religions des Romains et, au-delà même, notre approche de la notion de religion. Méthodiquement et inlassablement, il les a dégagées d’une vision réductrice et, dans une vaste synthèse anthropologique ouverte à l’ensemble des sociétés antiques, il a fait saisir leur singularité sur près d’un millénaire, du Ve siècle avant J.-C au IVe siècle après J.-C.
Article publié dans Histoire Magazine N°13
Trop souvent, en effet, ces religions étaient étudiées à l’aune du christianisme, ce qui, dès 1900, avait fait réagir Rémy de Gourmont dans un ouvrage,Le Paganisme éternel, publié par le Mercure de France: il y critiquait cette approche «de curés archéologues» tous acquis à une «littérature de préfigurations», dont Huysman était à ses yeux l’un des représentants les plus marquants. Mais surtout, John Scheid a travaillé à ce que les religions romaines ne soient plus étudiées à partir des concepts de la religion chrétienne: il a défini leur altérité ainsi que leur rapport spécifique avec le monde et les dieux, propres à ces hommes et femmes qui se considéraient comme religiosissimi mortales (« les plus religieux des mortels », Salluste, Guerre de Catilina, XII). Les conceptions théologiques des Romains n’étaient pas, ainsi que cela fut trop souvent écrit, des formes médiocres ou non abouties. En effet, «la croyance et la foi au sens chrétien n’existaient pas dans la Rome antique.Il existait un savoir sur le système du monde et sur les dieux, qui était transmis par un ensemble de rites ancestraux, et que l’on retrouvait sous forme élaborée dans la spéculation philosophique», expliquait John Scheid dans une conférence pour l’association Alle, le 5 octobre 2010.
Les religions romaines, qui ne connaissent ni Révélation ni Livre sacré, n’avaient pas les mêmes conceptions de la divinité et de la transcendance que les religions monothéistes: seule l’obligation rituelle s’imposait au pratiquant par des actes et des paroles immuables. Résolument immanentes, elles tissaient avec leurs rites un réseau multiple, à la façon d’une immense toile, qui reliait l’homme au divin à travers les signes manifestant la présence et la proximité du dieu ou de la déesse dans notre monde hic et nunc. L’univers d’ici-bas était séquencé pour les Romains par des pratiques rituelles multiples tandis qu’un chrétien, en dehors du catholicisme d’autrefois, imprégné de paganisme, est d’abord et avant tout relié à la divinité transcendante. John Scheid recherche ainsi la trace des gestes accomplis par les célébrants lors des cérémonies. Jusqu’à maintenant limités pour les services funéraires aux inscriptions ainsi qu’au traitement des défunts, les travaux des chercheurs intègrent désormais les gestes et les pratiques effectués au quotidien. L’étude des rites funéraires s’est enrichie notamment des données livrées par l’archéozoologie et l’archéobotanique. Ce que l’on nomme «l’archéologie du geste» doit beaucoup à John Scheid: les découvertes nombreuses comme celles effectuées par l’équipe de l’archéologue français William Van Andringa dans l’une des nécropoles de Pompéi (porte de Nocera) en témoignent. Par l’analyse précise des espaces et des objets, les spécialistes peuvent aujourd’hui conforter et compléter les informations fournies par les textes littéraires antiques, mais aussi les corriger.

Représentation d’un suovetaurile lors du rite public du lustrum. Bas relief Fin du ier siècle av J.-C. Musée du Louvre. Paris
Dans ce dernier ouvrage,Les Romains et leurs religions, qui se lit d’une traite, l’auteur se livre à une enquête active et passionnante sur les actes cultuels privés quotidiens des religions romaines, longtemps passés sous silence.
L’enquête est menée avec de précieuses réflexions méthodologiques qui constituent à elles seules une véritable didactique sur la manière d’aborder un rite: elle nous «désencrasse» de nos préjugés et nous redonne une singulière alacrité de jugement. Cette synthèse inédite prend la forme d’une fresque vivante de la piété intime et privée des Romains envers leurs dieux: elle fourmille d’exemples concrets, révélateurs et parfois émouvants qui montrent que les pratiques privées ne semblent pas s’être distinguées dans l’ensemble des pratiques publiques. Les patients d’Esculape offrent une illustration de ces liens, aussi bien publics que privés, entretenus avec la divinité: ils se rendaient au temple suivre la cure en buvant de l’eau au puits sacré. Puis en s’endormant sous un portique de l’enceinte sacrée, ils voyaient le dieu leur apparaître en songe: «l’un d’entre eux, Julianos, qui crachait du sang et avait été abandonné par tous, se vit révéler par le dieu qu’il devait aller prendre sur le triple autel des fruits d’un cône de pin et les manger pendant trois jours avec du miel. Il fut sauvé et revint et offrit publique-ment ses remerciements en face du peuple» (L. Moretti, Inscriptiones Graecae Urbis Romae,1, 1968)
Nous y voyons aussi Ovide, exilé au bord du Pont-Euxin (la mer Noire) par Auguste, offrir chaque matin son en-cens, en adressant ses supplications tout aussi bien au Divin Auguste, au Génie de Tibère et à la Junon de Livie, c’est-à-dire d’un côté à Auguste divinisé et de l’autre à la Puissance divine (Numen) des membres de la famille impériale. Et ce malheureusement pour lui sans effet (Pontiques, IV, 9,105-112).
Les textes littéraires également sollicités à propos des rites funéraires viennent compléter les observations de l’archéologie.
Dans une lumineuse analyse d’un passage des Florides d’Apulée(19), John Scheid, saisit sur le vif le processus en action de la séparation progressive des vivants et du mort. En effet, dans ce récit, un médecin aperçoit devant la porte d’une ville un mort placé sur son bûcher avec son repas funéraire.

Hecate. Statuette en bronze. Musée romain Nyon. Rémy Gindroz
Il se rend compte soudain que le mort n’est pas encore mort et demande donc à la famille de déplacer le repas funéraire prévu pour celui-ci vers la table où elle s’apprêtait à manger le repas sacrificiel. Les vivants allaient donc se nourrir des mêmes plats que ceux destinés à brûler lors de la crémation avec le mort. Cette séparation entre le repas, dit normal, et celui dont la vocation est de se consumer sur le bûcher exprime bien la distance qui commence à s’installer entre morts et vivants. D’autres rites comme celui du bris de la vaisselle auprès de la tombe permettent de comprendre les comportements des Romains: «Ou bien on “envoie”, dit John Scheid, c’est-à-dire on jette par terre les offrandes destinées aux défunts, pour marquer la différence avec les vivants, ou bien on détruit parfois par un coup les vases». C’est un rite qu’évoque entre autres Properce dans l’élégie où le fantôme de Cynthia revient de chez les morts pour lui faire des reproches: «Était-ce trop de me jeter quelques pauvres hyacinthes et d’apaiser mes cendres en cassant une jarre de vin.» (Élégies, IV, 7).
La Magie, qui pourrait sembler singulière dans ce domaine, fait partie, elle aussi, de ce vaste ensemble que constituent les rites religieux pratiqués dans les cultes privés. Elle n’est pas diabolisée, comme elle le sera plus tard au Moyen Âge, car elle ne choque personne: hormis pour les sceptiques qui en souriaient ou la critiquaient, il était courant chez les Romains de suivre plusieurs religions ou d’adhérer à des croyances magiques.
On ne s’étonnera pas de trouver ainsi dans la nécropole de Nocera une défixion (une malédiction) gravée sur sa propre tombe par Publius Vesonius Phileros à l’égard d’un homme, Marcus Orfelius Faustus, dont il avait fait inscrire quelque temps auparavant le nom sur son tombeau afin de lui témoigner son amitié. Cependant, à la suite de la trahison de ce dernier, qui lui intenta un mauvais procès, il décida de le maudire sur son tombeau en ces termes: «Ce-lui dont j’avais espéré qu’il serait toute présence de ce mauvais ami, en faisant décapiter sa stèle et boucher son tube pour les libations [1]. Comme le note John Scheid, Phileros lui souhaite de n’être accueilli ni par les dieux Pénates ni par les dieux Mânes, «comme si l’exclusion allait de pair et qu’il n’y avait pas de différence entre les différents registres cultuels». De fait, les pratiques magiques, comme les rites quotidiens, révèlent ici encore la dimension fondamentale de la piété religieuse dans l’univers des Romains.

Relief représentant Marc Aurèle. Sacrifice à Jupiter. Sculpture en marbre. 176-180 apr. JC Rome. Eglise des SS Luc et Martina
Les analyses aiguisées de John Scheid, sur les micro systèmes de la pensée religieuse des Romains et sur leurs enchaînements, sont des graines qui ne demandent qu’à s’épanouir une fois semées. En privilégiant les choix effectués par les Anciens eux-mêmes, elles nous aident à comprendre cette forme de spiritualité en actes qui se traduit aussi bien dans les rites privés que publics. Simplifions, comme il nous y invite, nos catégories et notre vocabulaire: au lieu de religion publique, privée, ou de magie, parlons simplement de religion et de piété des Romains. Et respectons-les. C’est ce qu’appelait de ses vœux John Scheid dans sa leçon de clôture prononcée le 3 mars 2016 au Collège de France, La religion romaine en perspective: «Les religions de Rome étaient peut-être méprisables pour les pères de l’Église, qui n’y voyaient comme Lactance, dans une formule magnifique, “qu’un mode rituel qui concerne uniquement le bout des doigts”, ritus ad solos digitos pertinens (Institutions di-vines, V, 20, 29). Mais cela ne signifie pas pour autant qu’elles étaient mortes. L’altérité de cette religion irrite certains chercheurs d’aujourd’hui, notamment dans les pays qui n’ont pas connu l’anthropologie sociale. Les sources attestent toutefois que ces coutumes sont restées bien vivantes, pendant les quatre premiers siècles de l’ère chrétienne, comme elles le sont encore de nos jours d’ailleurs, où ce type de religion est largement répandu et florissant. Il n’est pas excessif de dire que ce type de religion concerne une très grande partie de l’humanité. Qu’on rende donc à l’individu, au citoyen romain en l’occurrence, et à des centaines de millions d’autres humains, le droit de pratiquer leurs rites comme ils l’entendent.»
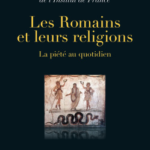
Les Romains et leurs religions. La piété au quotidien. Pas John Scheid, de l’Institut. 336 pages, Editions du Cerf 2023. 24€












