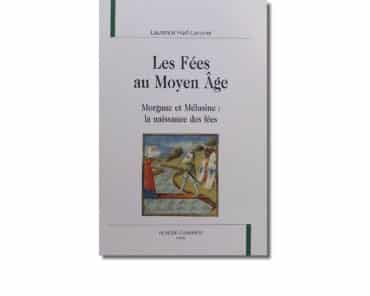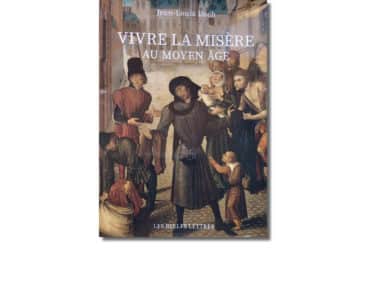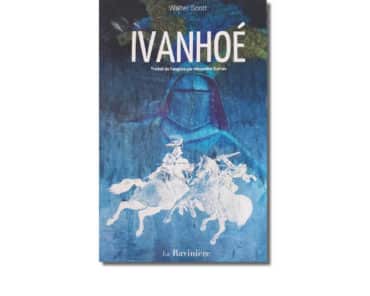Le champ de bataille d’Azincourt (Pas-de-Calais) n’est plus qu’une large pièce de labours mouillée par la pluie dans l’automne qui s’achève. S’il demeure aujourd’hui, de part et d’autre, quelques lambeaux de bois, rien ne permet de saisir la configuration des lieux où se noua, en 1415, l’un des drames majeurs de l’histoire de la France. À peine comprend- on que ce terrain, qui descend en pente douce jusqu’au village d’Azincourt, avait donné aux Anglais, qui en occupaient le point haut, un avantage certain. Face au silence qui domine le plateau d’Artois, il est difficile d’imaginer la fureur qui s’est déchaînée ici, il y a plus de 600 ans. Pour entendre le galop des chevaux qui s’élancent et les cris de guerre des chevaliers échauffés par le combat à venir, sans doute vaut-il mieux retourner aux archives.
Article publié dans Histoire Magazine N°13
Préparatifs
Le 25 octobre, cette année-là, tombait un vendredi. Jour de la Saint Crépin et Saint Crépinien. L’affrontement entre les deux armées était inéluctable.
Henri V, jeune roi d’Angleterre, avait tout fait pour l’éviter. Mais il avait mis trop de temps à trouver un passage sur la Somme et ses hommes étaient harassés. On mangeait mal, on dormait mal et la pluie persistante minait les esprits. Les Français, face à eux, voulaient se battre, même sans roi. La chevalerie française rassemblée à Azincourt allait montrer à ce monarque présomptueux, à la tête d’une troupe recrutée dans les campagnes de l’Angleterre et du Pays de Galles, ce qu’il en coûte de s’aventurer en Normandie. On ne le laisserait pas rejoindre Calais sans payer au prix fort le coût du voyage. Les Français, qui avaient pourtant déjà perdu des batailles contre les Anglais, conservaient le goût du panache, du beau fait d’armes, de la témérité irréfléchie. On pariait sur celui qui pourrait toucher le roi. Et, faut-il le préciser, lorsque l’on était prince ou chevalier, on risquait au pire d’être prisonnier, la «boucherie» étant réservée à la piétaille.
Il avait plu abondamment au cours des derniers jours, et toute la nuit encore. Les premières lueurs de l’aube se levaient sur la plaine détrempée. Henri V, arrivé la veille, avait installé son logis dans le village de Maisoncelle.
Ses troupes étaient exténuées pour avoir parcouru trois cents kilomètres en douze jours. Les vivres manquaient et les archers, depuis quelques jours, ne mangeaient que des noisettes et des mûres ramassées le long des chemins. La dysenterie sévissait depuis le siège d’Harfleur. Les Français, qui les avaient rejoints à marche forcée, étaient bien plus nombreux, peut-être deux fois plus. Les hérauts avaient déjà porté leur défi, pour proposer la bataille.

Henri V (1386-1422) Portrait. Anonyme. National Portrait Galley Londres. fth-images.
L’armée française s’était installée entre deux massifs boisés, celui d’Azincourt à sa droite, et celui de Tramecourt à sa gauche, deux villages modestes dans la clairière, qu’on distinguait par leurs clochers. À cet endroit, la plaine était large encore, mais elle allait en se resserrant, vers le sud et le village de Maisoncelle, à l’endroit où se tenaient les troupes anglaises. Dans l’espace qui séparait les deux camps, les charrues avaient retourné une terre profonde et humide, aux sillons gorgés d’eau dans l’attente des semailles. Les Français se trouvaient en contrebas de la pente. Ils allaient devoir déployer un effort plus grand pour rejoindre la ligne de front des deux armées.
Les Anglais durent être impressionnés par le formidable déploiement de forces que révélait le jour : une foule immense, des centaines de bannières qui claquaient au vent, des milliers d’armures que les premiers rayons du soleil laissaient refléter. Le connétable, Charles d’Albret, commandait les troupes françaises en l’absence du roi, demeuré à Rouen. Depuis onze jours déjà, il tentait de rejoindre les Anglais et n’était pas mécontent de leur avoir enfin coupé la route. Il avait sous ses ordres environ 10 000 hommes, peut-être davantage, dont beaucoup de chevaliers de renom. Les hommes d’armes appartenaient à la noblesse. Les villes avaient dépêché des milices, des fantassins et des arbalétriers que les nobles français, forts d’une tradition élitiste des combats, ne tenaient pas en grande estime. De son côté, Henri V commandait 6 000 hommes environ, dont un millier d’hommes d’armes et le reste composé d’archers. Ces spécialistes du longbow étaient redoutés pour leur adresse et, à plusieurs reprises déjà, leurs flèches meurtrières avaient donné la victoire à l’armée anglaise. Le jeune monarque, qui n’avait pas encore atteint ses trente ans, avait néanmoins une longue expérience de la guerre. Comme prince de Galles, il avait combattu aux côtés de son père, Henri IV, dans sa guerre contre Owen Glendower et ses troupes, recrutées en Angleterre, étaient com- posées d’éléments aguerris.

Ce 25 octobre 1415, le soleil tarde à paraître. Tous attendent l’heure de la bataille. Les hommes s’observent de loin. Ils se jaugent. Les chevaliers avaient déjà revêtu leurs armures, avec l’aide de leurs valets.
Les préparatifs du combat ont été décidés pendant la nuit. Les Anglais ont renforcé leur dispositif, dans le plus grand silence. Les hommes d’armes français sont restés sur place, en selle.
On distingue les armes du maréchal Boucicaut, du duc d’Orléans, des ducs de Bourbon de Bar et d’Alençon, de David de Rambures, le grand maître des arbalétriers, du seigneur de Dampierre, pour lors amiral de France, de Guichard Dauphin. Le duc de Bourgogne, Jean sans Peur, n’a pas rejoint l’ost royal, mais ses frères, Antoine de Brabant et Phi- l i p p e de Nevers sont présents ou annoncés. On espère encore le renfort de la Bretagne. Un bon kilomètre sépare les deux armées.

Le matin de la bataille d’Azincourt, 25 octobre 1415. Vers 1884, par Sir John Gilbert (1817-1897).
Les Forces en présence
Les Français sont rangés sur trois lignes. Leur avant-garde se compose de 3 000 hommes d’armes, renforcés sur leurs ailes par des cavaliers. Comme toujours, au nom de l’éthique chevaleresque, les seigneurs les plus importants ont obtenu le privilège de marcher en avant. Derrière cette avant garde, à 150 mètres environ, se tient le corps de bataille principal, fort de 4 000 hommes. Il est commandé par les comtes d’Aumale, de Dammartin et de Fauquembergues. Les hommes des deux premiers corps de bataille ont laissé les chevaux à l’arrière, aux mains des valets. Une partie des hommes d’armes va combattre à pied, car on se méfie des charges de cavalerie qui se rompent, comme à Maupertuis, sur le mur des archers anglais. Les chevaliers français ont revêtu leurs armures d’acier, protectrices, mais pesantes. Les nobles, évidemment, préfèrent com- battre montés, car c’est leur manière de pratiquer leur art, dans les tournois comme à la guerre. Mais le combat au corps à corps, qui rappelle le duel, ne manque pas de panache non plus. L’objectif est de bousculer, à l’aide de lances, les lignes ennemies, puis de s’ouvrir un passage à l’épée jusqu’au roi anglais. Les étendards désignent les seigneurs, et les hommes qui combattent avec eux.
Le troisième bloc des combattants compose l’arrière garde, qui regroupe les hommes de moindre noblesse, ou de simples soldats et des hommes de traits, dont on n’a pas voulu s’encombrer. Ni la topographie des lieux ni la tactique employée ne se prêtent à l’intervention des archers et des arbalétriers. On préfère bousculer les lignes ennemies en marchant sur elles. Des hommes d’armes montés se tiennent sur les flancs, en deux contingents de cavalerie lourde, soit environ un millier de cavaliers, chargés de briser les lignes des archers anglais.
Les Anglais ont déployé leur bannière de saint Georges «d’argent à la croix de gueule». L’étendard d’Henri V, «écartelé aux fleurs de lys et léopards», est déployé, il est au centre, à côté du maréchal d’Angleterre. Le roi anglais, après avoir écouté la messe et rendu louange au Seigneur, a disposé son armée sur une seule ligne, jusqu’à toucher l’orée des deux forêts.
Les archers ont pris place en avant, sur les côtés, comme à la bataille de Poitiers, où ils avaient anéanti l’armée française en se tenant à l’abri d’un mur de pointes.
D’autres se trouvent intercalés entre les troupes en armures, sur quatre rangs de profondeur. Le duc d’York commande l’aile droite, le sire de Camoys l’aile gauche. Les longbowmen sont placés sous le commandement du duc d’Erpyngham, le maréchal d’Angleterre. Mais deux cents d’entre eux ont été disposés, en embuscade, dans le bois de Tramecourt pour empêcher un éventuel encerclement des lignes anglaises par les Français. Durant la nuit, les archers ont planté devant eux des pieux de bois taillés en pointe, comme ils ont l’habitude de le faire, afin de briser les charges de la cavalerie. Contrairement aux hommes revêtus de leur armure, qui pèse au bas mot une vingtaine de kilos, les archers sont piètrement protégés, mais demeurent libres de leurs mouvements, «en leurs pourpoints, les chausses avalées, les aucuns tout nu-pieds», dit la chronique.
Le jour est désormais levé depuis trois bonnes heures et il ne se passe rien, ou plutôt les négociations s’éternisent. Les deux armées se font face, sans bouger. Seuls les chevaux hennissent, nerveux. Des cris parfois fusent. Les Français ont exigé la renonciation du roi d’Angleterre à la couronne de France. Les Anglais, qui ont tout à craindre d’un affrontement, ne demandent que l’accès à Calais et se tiennent prêts à rendre toutes les forteresses qu’ils occupent dans le nord du royaume, Harfleur y compris. Mais les émissaires dialoguent sans parvenir à s’entendre.
Un combat sans pitié
À dix heures, faute de trouver un terrain d’entente, il faut s’apprêter à mourir ou à être prisonnier. Les hérauts, témoins officiels de la bataille, prennent position sur un monticule, à l’écart des champs gonflés d’eau qui vont devenir le théâtre de la bataille. Le héraut français se nomme Montjoie. Il va lui revenir la charge de désigner le vainqueur. Les soldats anglais mettent un genou en terre et baisent le sol. Les prêtres sont restés à l’arrière, avec les chariots du convoi. La question est désormais de savoir qui attaquera. Les Français ne bougent pas. Henri V fait alors avancer ses hommes, sur 600 mètres. Délicat, l’exercice exige une grande discipline pour éviter d’être bousculé par l’ennemi pendant le mouvement. En prenant cette initiative, Henri V allait provoquer la confrontation, mais, surtout, il fixait sa ligne de front à un endroit plus favorable, là où la clairière était plus resserrée, bien protégé sur ses flancs par le couvert végétal. Les archers, armés de lourds maillets, plantent de nouveau leurs pieux. Les Français laissent faire. Ils veulent une belle charge, dans l’esprit de la chevalerie, et n’entendent pas laisser le soin à la piétaille d’entamer les hostilités. Les archers anglais se mettent donc en position, les vingt-quatre flèches de leur carquois fichées à leurs pieds. Le maréchal d’Angleterre lance l’attaque au cri de «frappez!». Ils commencent à décocher une première volée de flèches. L’effet du tir est d’autant plus impressionnant qu’il est effectué dans un même mouvement. À cette distance, les flèches ne sont pas destinées à tuer, plutôt à effrayer l’adversaire.
Les archers tirent presque à la verticale, tous en même temps, et c’est une pluie bruyante qui s’abat, après une course hyperbolique, sur les épaules des Français et sur leurs chevaux.
Le connétable, le maréchal et les princes s’adressent à leurs troupes, les encourageant à combattre avec hardiesse. Les trompettes se mettent à sonner.

La première charge des chevaliers français met en branle la cavalerie placée sur les ailes, comme cela avait été convenu, derrière Glignet de Brabant et Guillaume de Saveuse. Tous n’ont pas eu le temps de se tenir prêts. Les lourds destriers, lancés au galop, s’en- foncent dans la terre molle des labours. Les archers anglais les assaillent de flèches. Comme toujours, dès qu’ils sont mis à bas de leur monture, les chevaliers encombrés de leur pesant équipement peinent à se redresser. Les chevaux, dont les flancs sont percés par la pointe acérée des flèches, s’affolent, échappant au contrôle de leur cavalier. Certains font demi-tour et heurtent l’avant-garde française. D’autres s’empalent sur le piège des pieux que les cavaliers voient trop tard, dans le mouvement de recul des archers. Une fois l’homme à terre, les archers l’achèvent à coup de dague, là où l’armure demeure vulnérable. Le connétable, qui comprend le danger, fait charger l’avant-garde, qu’il commande en personne. Les archers anglais rectifient leur tir. Il s’agit désormais de neutraliser l’adversaire. Ceux qui ne peuvent se protéger d’un pavois doivent avancer tête baissée, mais l’état du terrain rend leur marche difficile. Les archers anglais multiplient les salves; les dernières, car leurs réserves de flèches se sont épuisées. Les chevaliers français ont été contraints de baisser la visière de leur casque. Il est plus difficile de combattre ainsi ; on étouffe vite, surtout lorsque l’effort physique est intense.
Le chroniqueur de Saint-Denis écrira : «Les Français marchaient dans la boue, qui s’enfonçait jusqu’aux genoux. Ils étaient déjà vaincus par la fatigue avant même de rencontrer l’Anglais».
Ce n’est pas tout à fait vrai, car malgré les difficultés, les Français atteignent la ligne anglaise qui recule sous la poussée. La victoire semble même à leur portée. Les Anglais reculent encore. Les Français poussent leur avantage en direction des trois étendards que tous convoient : ceux du roi, du duc d’York et de lord Camoys. Henri V, bousculé par le duc d’Alençon, est presque mis à terre. On se gêne beaucoup. Les hommes avancent en rangées compactes. Les premiers rangs sont bousculés par les suivants. La mêlée est devenue si dense que les combattants peinent à lever leurs armes pour combattre. Quand un homme en armure tombe au sol, ceux qui se trouvent derrière lui, poussés par les suivants, n’ont pas d’autre choix que de l’enjamber ou de le piétiner. Les premières lignes se trouvent ainsi encombrées de corps à terre. Des témoins visuels parlent même d’un véritable mur fait de cadavres d’hommes et de chevaux mêlés.
Triomphe anglais
Alors, les Anglais se ressaisissent et effectuent une percée dans les rangs français. L’avant-garde française est taillée en pièces. Ce qu’il reste de ses forces cherche à battre en retraite, mais se retrouve face au deuxième corps de bataille français qui, lui, continue d’avancer. Les Anglais voyant la victoire à portée de main, malgré les ordres, se précipitent pour multiplier les prisonniers. Pour beaucoup d’entre eux, la rançon d’un seigneur de haut rang était la seule façon d’accéder à la fortune. De nombreux Français, qui pensent la bataille perdue, se retirent. D’autres arrivent en retard, comme le duc de Brabant qui, parvenu sur les lieux avec onze de ses chevaliers, se rue sur la mêlée dans une charge inutile et mortelle. Le second corps de bataille est enfoncé à son tour, les Anglais se dispersent, à la recherche de bonnes prises. Ramenés à l’arrière, les prisonniers sont répartis selon leur rang. On leur a ôté le casque, afin de rendre impossible toute reprise de combat. On demande leur nom; on s’accorde sur l’identité de l’auteur de la prise. Les captifs sur parole donnent un gant en gage de soumission. Le roi d’Angleterre, craignant que son convoi ne soit pillé, l’a fait ranger à l’arrière, dans les vergers du village. Soudain, on lui signale des mouvements dans ce secteur, l’arrivée par le sud d’une troupe hétéroclite où figurent de nombreux paysans, emmenée par le seigneur d’Azincourt. Comme l’arrière-garde française est restée à cheval, prête à s’engager, Henri V comprend qu’il court le risque d’être pris à revers. Il donne alors l’ordre, contraire à tous les usages de la guerre chevaleresque, de tuer les prisonniers. Mais il n’est pas exécuté. Ceux qui détenaient un captif ne voulaient pas voir s’échapper de cette manière une occasion de faire fortune. Quand il comprend qu’il ne sera pas obéi, Henri V demande à un gentilhomme de confiance de prendre avec lui 200 archers et d’égorger les chevaliers captifs. Il fait encore incendier une grange où d’autres nobles sont détenus. Une partie de la noblesse française meurt de cette manière, la gorge tranchée par de simples archers. Les Français qui n’avaient pas combattu, voyant cela, quittent le champ de bataille.
Le roi d’Angleterre avait perdu dans l’affrontement 1 600 de ses hommes, dont le duc d’York, son grand-oncle, le comte de Suffolk. Il regroupa ses officiers et fit venir les hérauts, chargés de donner le nom du vainqueur et de nommer la bataille. Henri V s’enquit du nom du château qui se trouvait derrière la ligne des arbres. On lui répondit que le village avait pour nom Azincourt (Agincourt, en anglais). Il déclara alors «Pour autant que toutes batailles doivent porter le nom de la prochaine forteresse où elles sont faites, celle-ci, maintenant et perdurablement aura nom : la Bataille d’Agincourt». Il pleuvait de nouveau. L’heure des vêpres approchait. Henri V se retira dans son logis de Maisoncelle. Ses troupes avaient entrepris de désarmer les cadavres des Français. Ils trouvèrent de la sorte plusieurs chevaliers encore en vie, dont le duc d’Orléans, qui fut ainsi fait prisonnier, mais aussi Richemont qui, plus tard, deviendrait connétable à son tour et serait pour les Anglais un adversaire redoutable. À l’arrière, les vingt chirurgiens de l’armée royale étaient déjà à l’œuvre. On fit bouillir les corps du duc d’York et de Suffolk, pour emporter leurs os en Angleterre. Le lendemain matin, en traversant ce champ de désolation, couvert de cadavres, d’animaux morts et d’agonisants, les Anglais achevèrent, pour leur éviter des souffrances plus grandes, les malheureux Français qui gémissaient encore. Plus tard, sous l’autorité de l’évêque d’Arras, des centaines de paysans seraient mobilisés pour enterrer les morts. Le soir était tombé. Le roi ordonna qu’on entassât dans une grange le surplus des prises et le corps des Anglais tués au combat, puis il y fit mettre le feu. Des milliers de Français avaient perdu la vie sur le champ de bataille, et non des moindres : les deux frères du duc de Bourgogne, le duc de Brabant et le comte de Nevers, le duc d’Alençon, le duc de Bar, le connétable, l’amiral.
La «fine fleur de la chevalerie française» avait péri dans la boue d’Azincourt. Les Anglais emportaient avec eux mille cinq cents prisonniers, échappés au massacre.
On comptait parmi eux le duc d’Orléans, le duc de Bourbon, le comte de Richemont, Boucicaut, qui allaient être menés en Angleterre dans la suite d’Henri V.

Vigiles du roi Charles VII, Martial d’Auvergne, vers 1484. Manuscrits français , BNF, Paris.
Les Anglais quittèrent Maisoncelle tôt, le lendemain matin, avec leurs prisonniers. Le 16 novembre, ils traversaient la Manche. Le «voyage de France» du jeune roi s’achevait. Il n’avait perdu que sa couronne, dérobée dans ses chariots par les pillards du seigneur d’Azincourt. La France allait pleurer ses morts. Le retour à Londres d’Henri V et de son armée fut un triomphe, d’autant qu’on avait cru un moment que celle-ci avait été une défaite. La foule acclama les vainqueurs. La légende s’empara aussitôt de l’événement et une communication bien orchestrée transforma l’affrontement des deux camps en un combat symbolique, celui d’un nouveau David, venant de terrasser le Goliath français. Azincourt allait devenir l’un des principaux épisodes de la geste britannique. Les chansons fleurirent aussitôt sur le thème du Crispin’s Day. Depuis le chef-d’œuvre de Shakespeare jusqu’au XXe siècle, les occasions de rappeler la gloire d’Henri V jamais ne cessèrent pour exalter le patriotisme anglais. Le souvenir de la bataille d’Azincourt ne s’est pas achevé avec l’œuvre de Skakespeare. Le cinéma, depuis, l’a prolongé, à travers le film de Laurence Olivier, en 1944, Henri Y, puis ceux de Kenneth Branagh (1989) et de David Michôd (The King, 2019). Du côté français, la bataille d’Azincourt signait l’échec de la chevalerie française par son archaïsme. Pendant plusieurs générations, cette cuisante défaite allait nourrir le désir de revanche de ceux qui avaient vu périr un père ou un frère. Si l’infanterie et l’archerie anglaises avaient, une fois de plus, montré leur supériorité militaire sur la charge de cavalerie lourde, c’est une autre arme qui allait assurer la victoire des Français sur les champs de bataille : l’artillerie à poudre. •