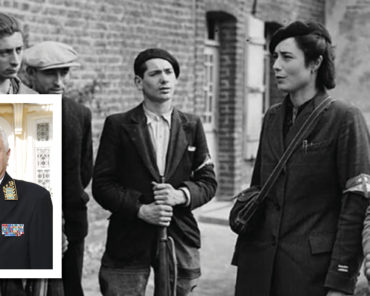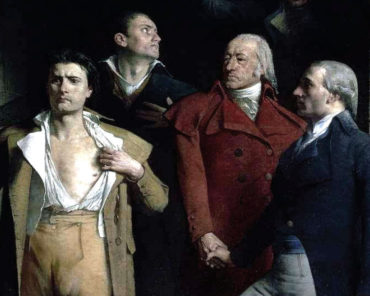Jean-Nicolas : Pendant les vacances, je suis allé visiter un château fort. C’était fantastique.
L’historien : Qu’est-ce qui t’a plu ?
Jean-Nicolas : Il y avait des murs très hauts, des tours, de sombres couloirs… Fantastique, je te dis ! Mais comment étaient les premiers châteaux forts ?
L’historien : D’abord, il faut savoir que le terme « château fort » n’apparaît qu’en 1835. Longtemps, on a utilisé un mot latin : le “castrum”. Les premiers sont appelés « mottes castrales ». On commence par ériger un grand tertre de terre, les plus hauts peuvent atteindre 60 mètres de haut, les plus modestes 10. Au sommet, on dresse une palissade de pieux. Au centre s’élève une grande tour, une sorte de fortin, un donjon. C’est assez facile à construire ; les matériaux sont pris sur place. Il suffit d’avoir une main-d’œuvre importante ; on réquisitionne donc les habitants. Les mottes se sont multipliées vers la fin du IXe siècle et le début du Xe au moment des invasions venues d’Europe du nord ou du sud, ceux que tu connais sous le nom de Vikings et de Sarrazins.
Jean-Nicolas : Qui habite dans les mottes ?

L’historien : C’est le début du système seigneurial et du système féodal. Un personnage est chargé par un prince de défendre une région ; en échange il aura droit de lever des taxes. Son premier geste est de construire un château. Il est à la fois un édifice défensif et la résidence du seigneur. À proximité se fixent des paysans qui espèrent pouvoir se réfugier derrière une enceinte de bois en cas d’attaque. C’est ce qu’on va appeler la basse-cour. Comme les rois ne sont pas très puissants, beaucoup de seigneurs se mettent à construire des châteaux pour montrer qu’ils sont indépendants.
Jean-Nicolas : On peut visiter des mottes castrales ?