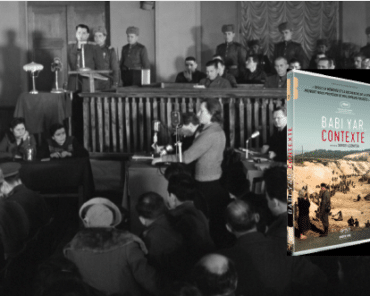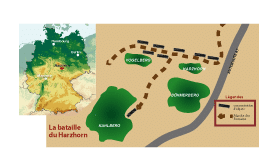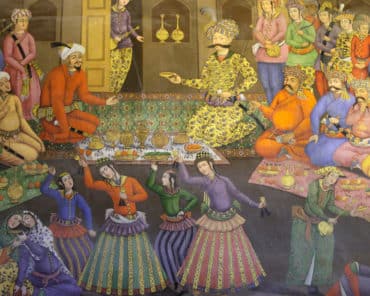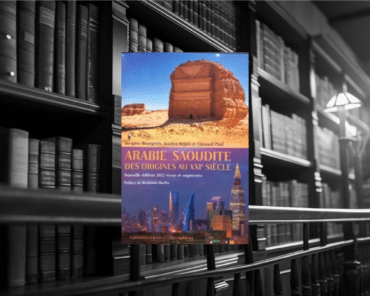Les mirages du « moment unipolaire » (Krauthammer)
En janvier 1990, il y a à peine 30 ans, dans son discours sur l’État de l’Union au Congrès, le président républicain George Bush Sr annonçait, quelques semaines après la chute du mur de Berlin, le triomphe mondial de l’Amérique face au communisme («Comme ce nouveau monde prend forme, l’Amérique se tient au milieu d’un cercle croissant de liberté, aujourd’hui, demain et pour le nouveau siècle — […] — cette nation, cette idée nommée Amérique a été et sera toujours un nouveau monde, notre nouveau monde.») Cette affirmation de Bush Sr était renouvelée et confortée après l’intervention militaire victorieuse un an plus tard pour libérer le Koweït de l’envahisseur irakien. Le président étasunien léguait même à la postérité le concept de nouvel ordre mondial, reprise avec enthousiasme par son successeur pourtant démocrate Bill Clinton quelques mois plus tard. Ce dernier évoquait avec emphase lors de son discours d’investiture du 20 janvier 1993 «un monde baigné par le soleil de la liberté».
Cette victoire -par défaut de rival – de la superpuissance étasunienne au début des années 1990 reposait sur au moins quatre piliers historiques. C’était d’abord le succès du récit de la puissance démocratique de Franklin Roosevelt avec ses quatre libertés proposées en janvier 1941 pour la reconstruction du monde d’après-guerre — liberté d’opinion, liberté de croyance, liberté de vivre à l’abri du besoin et liberté de vivre à l’abri de la peur. Ces quatre libertés servaient de base à la Charte de l’Atlantique d’août 1941 puis à la Charte des Nations Unies de 1945. Elles étaient ensuite la bannière derrière laquelle les alliés des États-Unis furent réunis dans la guerre froide contre le communisme. Comme le montre Ludovic Tournès dans son récent livre l’Américanisation, une histoire mondiale (2020), cette double promesse d’une démocratie politique libérale et d’une augmentation considérable du niveau de vie moyen sont après 1947 les socles contre l’URSS de la reconstruction de l’Europe de l’Ouest par le plan Marshall et de la refondation des deux anciens ennemis, Japon et Allemagne. Ce messianisme démocratique des États-Unis, assumé tour à tour contre le nazisme puis le communisme, faisait la synthèse de la Destinée Manifeste, promouvant après 1845 l’élection par la puissance divine de la nation américaine pour conquérir le sous-continent et du wilsonisme de la Première Guerre mondiale. Wilson avait le premier voulu étendre au monde le principe américain de souveraineté démocratique de chaque État vis-à-vis de ses voisins, cherchant selon ses propres mots du 22 janvier 1917 à «étendre la doctrine de Monroe au monde».
Mais ce premier élément de la victoire apparente des États-Unis en 1991 était aussi indissociable d’une globalisation économique portée par les progrès mondiaux du libre-échange encouragés par les États-Unis depuis Wilson. Le troisième des quatorze points de Wilson en 1917 invitait toutes les nations du monde à abaisser les barrières au commerce, comme le président des États-Unis avait déjà rompu lui-même avec le protectionnisme traditionnel des États-Unis en diminuant brutalement les tarifs douaniers sur les importations en 1913.
Pour Wilson, disciple de Kant et Montesquieu, une interdépendance commerciale accrue était une garantie accrue de sécurité collective entre les différents pays du monde.
Cette conviction, reprise et amplifiée par son ancien sous-secrétaire d’État Franklin Roosevelt, aboutit après 1945 à une augmentation sans précédent des échanges commerciaux mondiaux qui prenaient une part croissante à la production de richesses. Sous l’effet des accords du General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) de 1947 conclus à l’initiative de la présidence Truman et de leur renouvellement régulier par des cycles de négociation, les tarifs douaniers mondiaux baissaient considérablement entre 1950 et 1995. Et pour un indice base 100 en 1950, le commerce mondial en volume était multiplié par dix en 1985 et par vingt en 2000. Cette ouverture commerciale des économies capitalistes de la guerre froide était bientôt parachevée en 1995, après la fin du monde bipolaire, par la transformation du GATT en Organisation Mondiale du Commerce (OMC), accueillant 128 États contre 23 pour le GATT en 1947.
Cette globalisation commerciale du second vingtième siècle véhiculait par ailleurs un troisième fondement de la toute-puissance étasunienne d’après-guerre froide. Elle avait servi depuis 1945 de vecteur à la diffusion de la culture de masse américaine transformée en culture mondiale par la domination des firmes transnationales américaines du divertissement et de l’information. L’État américain imposait à ses nouveaux alliés de la guerre froide d’ouvrir leurs écrans aux productions cinématographiques d’Hollywood qui acquéraient une position dominante. En 1991, 93 % des films diffusés au Royaume-Uni, 68 % en Italie et 58,7 % en France avaient été produits aux États-Unis par les studios hollywoodiens. Cette mainmise américaine sur les contenus culturels mondiaux était redoublée par l’essor à partir de 1995 de l’économie internet dans la- quelle des firmes de haute technologie américaines — sans cesse renouvelées par un processus concurrentiel de destruction créatrice (Google fondée en 1998) — tiennent une place prépondérante.

Le président Kennedy s’adressant aux marins de l’USS Enterprise, premier porte-avions à propulsion nucléaire des États-Unis le 14 avril 1962. Jfklibrary. org. Archives.
Mais le facteur le plus essentiel et concret de cette domination mondiale de la superpuissance étasunienne de la fin du XXe siècle était sa suprématie militaire et navale, bâtie depuis la Seconde Guerre mondiale. Le Victory Program de 1942 contre l’Axe, confortant les programmes de réarmement naval massifs de 1938 et 1940, avait fait des États-Unis un arsenal de la démocratie indépassable pour des décennies.
Grâce à une dépense militaire bien supérieure en continuité à celle de tous les autres pays du monde non communiste, les États-Unis pouvaient même réarmer l’Europe de l’Ouest dans le cadre de l’OTAN après 1949 (Mutual Defense Assistance Program puis Mutual Defense Security Act de 1951) avant de fournir à l’ancienne puissance impériale britannique ses vecteurs d’emport des armes nucléaires (accords de Nassau de décembre 1962).
L’avance technologique militaire des États-Unis leur permettait d’abord de maintenir une parité stratégique avec l’Union soviétique pendant quarante ans — à la fin de la guerre froide en 1990, les États-Unis détenaient un aussi grand nombre de têtes nucléaires (environ 10 500), mais possédaient une avance technologique sur certains armements de pointe.
Les États-Unis étaient seuls à détenir des porte-avions à propulsion nucléaire que l’URSS communiste n’avait su construire.
Et là encore, l’effondrement soviétique laissait la place à une superpuissance militaire américaine muée en bras armé de la communauté internationale, lors de la guerre du Golfe en janvier-mars 1991. Ce conflit devenait une vitrine de l’avance technologique militaire des États-Unis, le président George Bush vantant la réussite des missiles Patriot, guidés par ordinateur, pour intercepter les Scuds irakiens — une première en condition de combat.
Quelques mois après cette démonstration de force militaire, Colin Powell, chef d’état-major interarmées américain qui avait préparé et supervisé la guerre du Golfe aux côtés du président Bush Sr, pouvait écrire en 1992 dans la revue Foreign Affairs : «Aucune autre nation n’a eu la puissance que nous possédons sur cette terre. Et plus important, aucune autre nation n’a reçu une telle confiance en sa puissance. Nous avons l’obligation de mener.» À Washington, une fièvre triomphale d’impérialisme démocratique gagnait tous les cercles dirigeants : le think tank Project for a New American Century (PNAC) fut fondé en 1997 autour de penseurs néoconservateurs Robert Kagan et Richard Perle, proposant de procéder à une démocratisation mondiale par l’usage de la force militaire. Le PNAC suggérait en janvier 1998 dans une lettre publique au président démocrate Clinton de procéder au renversement définitif du régime irakien de Saddam Hussein afin de propager au Moyen-Orient la démocratie et le libéralisme économique. Si cette proposition restait lettre morte, nombre des membres du PNAC rejoignaient l’équipe du nouveau président Bush Jr (Rumsfeld, Wolfowitz) et y étaient les promoteurs après le 11 septembre 2001 de la reconstruction d’un Moyen-Orient démocratique par la guerre. L’hyperpuissance, selon l’expression du ministre français des Affaires étrangères Hubert Védrine en 1998, ne semblait plus avoir de limites.
2001-2021 : les deux décennies terribles de la superpuissance

Le président G.W Bush préparant sa première allocution à la nation dans une école de Floride alors que le World Trade Center est en flammes à la TV le 11 septembre 2001.
Un quart de siècle plus tard, cette démesure militaire et stratégique des États-Unis et leur prétention hégémonique paraissent singulièrement écornées. En 2021, Joe Biden, président des États-Unis depuis quelques mois, ordonnait en effet, un retrait définitif des forces militaires d’Afghanistan achevé le 30 août. Les États-Unis terminaient dans la retraite et la confusion le plus long conflit extérieur de leur histoire, entamé fin 2001 au lendemain des attentats djihadistes d’Al Qa’ida du 11 septembre à New York. Ce déploiement militaire avait certes abouti en mai 2011 à l’élimination au Pakistan, après dix ans de traque, du chef historique d’Al Qa’ida, le djihadiste arabe Oussama Ben Laden, par les forces spéciales étasuniennes. Les autres principaux responsables d’Al Qa’ida étaient décimés dans les districts pakistanais frontaliers du Waziristan.
Le concepteur des attentats du 11 septembre. Khaled Cheikh Mohammed, est en 2022 tenu prisonnier au secret dans la base américaine de Guantanamo depuis plus de 15 ans en attente de son jugement.
Mais les talibans afghans, chassés du pouvoir fin 2001 par l’offensive des États-Unis, auxquels ils avaient à l’époque refusé de livrer les chefs d’Al Qa’ida, revenaient triomphalement dans Kaboul dès le 15 août 2021 et forçaient les derniers soldats étasuniens à un départ précipité.
Cet échec militaire et idéologique faisait écho au départ des soldats étasuniens d’Irak en 2011 après huit ans de présence. Certes, conformément au rêve néoconservateur du PNAC, Saddam Hussein et son régime moribond avaient été éliminés en quelques semaines par la toute puissante armée des États-Unis au printemps 2003, amenant le président Bush Jr à son imprudente célébration de la «mission accomplie». Mais le vide politique et institutionnel laissé par l’effondrement de l’État local produisait une résurgence des conflits communautaires en Irak entre sunnites et chiites et l’implantation d’Al Qa’ida en Irak sous la conduite d’Abou Moussab Al Zarqawi. Ce terroriste sanguinaire multipliait de 2004 à 2006 les attentats suicides, commis indifféremment contre des troupes étasuniennes d’occupation d’Irak transformées en cible ou contre des mosquées chiites. Après plusieurs années d’une stabilisation militaire difficile, l’administration Obama choisit en 2009, sous la conduite du vice-président Biden, d’organiser le transfert de l’autorité au gouvernement al-Maliki avant le retrait définitif des troupes étasuniennes fin 2011. Cet autre départ précipité et l’illégitimité du pouvoir chiite d’al-Maliki aux yeux des sunnites irakiens nourrirent la montée en puissance de l’État islamique et sa prise de Mossoul en juin 2014. Les États-Unis étaient alors contraints de revenir en Irak à la tête d’une coalition internationale pour mener des frappes aériennes contre l’État islamique (opération Inherent Resolve), qui battait en retraite en 2017 sans que cela ne soit en rien définitif. En vingt ans (2001-2021), les États-Unis avaient donc mené en parallèle les deux guerres les plus coûteuses de leur histoire après la Seconde Guerre mondiale. Le centre d’études Watson de l’université de Brown a chiffré le coût financier des seules dépenses directes de guerre de 2001 à 2021 à 5500 milliards de dollars, soit l’équivalent d’un cinquième de la dette fédérale actuelle des États-Unis. Mais quand la Seconde Guerre mondiale installa les États-Unis comme superpuissance régulatrice de l’ordre international, la «longue guerre» contre le terrorisme semble avoir considérablement affaibli leur rang mondial.

Les présidents Obama et Hu Jintao et leurs conseillers pour le Nuclear Security Summit de 2010 à Washington. www.obamawhitehouse.archives.gov
Le paradoxe est pourtant que la puissance militaire des États-Unis reste presque aussi incontestée qu’à la fin des années 1990. Selon les chiffres du Stockholm International for Peace Research Institute (SIPRI), les États-Unis ont engagé en 2020 avec 778 milliards de dollars un montant de dépenses militaires supérieur à celui combiné de leurs onze principaux concurrents, dont la Chine. Même si la Chine mène un réarmement continu (un quart de siècle de hausse des dépenses militaires), ses dépenses de défense ne représentent toujours qu’un tiers de celles des États-Unis. Et si la Chine essaie depuis une décennie d’acquérir une avance décisive sur certains systèmes d’armes de haute technologie, comme le missile hypersonique, elle a toujours un retard conséquent sur les fondements de la projection de puissance. Les États-Unis ont fait de la marine l’outil primordial, conformément à la doctrine de l’amiral Mahan, de leur expansion mondiale depuis le tour du monde de la Great White Fleet (1907-1909) de Theodore Roosevelt. En 2021, la Navy américaine embarque deux fois plus de tonnage que la marine chinoise, malgré un nombre inférieur de navires. Et la Chine attend toujours de lancer son premier porte-avions à propulsion nucléaire quand les États-Unis en ont onze à la mer en permanence. Par ailleurs, les retraits d’Afghanistan et d’Irak ne sont pas des anomalies dans l’histoire de la puissance étasunienne.
La brève conquête coloniale des États-Unis avait commencé par une guerre meurtrière (plus de 4600 soldats américains tués, mais au moins 200 000 civils philippins morts en trois ans) aux Philippines (1899-1902), critiquée par un Mark Twain pour son inhumanité brutale. Et l’échec complet au Vietnam, réunifié sous autorité communiste en 1976 un an après l’évacuation des derniers ressortissants américains à Saigon, n’avait en rien empêché quinze ans plus tard le triomphe apparent des États-Unis dans la guerre froide.
Début du XXI siècle : une destinée toujours aussi manifeste ?
D’où vient alors le sentiment de déclin de la puissance internationale des États-Unis sur lequel le républicain Donald Trump a bâti sa conquête du pouvoir en 2016 ? Car, au-delà de son fameux slogan America First («Les États-Unis d’abord») emprunté à Harding, président républicain des années 1920 élu sur le refus de la participation des États-Unis à la Société des Nations, Donald Trump décrivait dans son discours d’investiture du 20 janvier 2017 des États-Unis usés et ruinés par des années de déploiement à l’extérieur («Et nous avons dépensé des milliards et des milliards à l’étranger pendant que nos infrastructures déclinaient et tombaient en ruine.») La première cause est l’épuisement du récit démocratique de l’hyperpuissance qui a été fragilisé par ces années interminables de guerre contre le terrorisme. La prétention des États-Unis à incarner et diffuser à l’échelle mondiale le libéralisme démocratique s’est d’abord télescopée avec les errements de la puissance militaire. Les conflits en Irak et Afghanistan ont pointé — après les Philippines et le Vietnam au XXe siècle — les tensions irréconciliables entre valeurs morales proclamées et pratiques guerrières. En 2004, la révélation des tortures et sévices commis à grande échelle par des soldats étasuniens dans leur prison militaire d’Abou Ghraïb en Irak démentait toute finalité libératrice de l’hégémonie étasunienne. Et la rédaction dès 2002 de mémos juridiques secrets rationalisant cet usage de la torture en interrogatoire par la CIA ou l’armée étasunienne démontrait l’éloignement de l’administration Bush des normes démocratiques de l’État de droit.
La supériorité technologique permettait aussi de généraliser après 2009 les frappes ciblées «au lointain» par des drones américains manœuvrés depuis les États-Unis (plus de 50 000 frappes de drones en Afghanistan, Irak et Syrie entre 2013 et 2018 selon des documents internes du Pentagone révélés fin 2021 par le New York Times).
Si ces frappes invisibilisent la guerre et son coût humain et matériel auprès d’une population américaine de moins en moins convaincue, elles délégitiment en profondeur la position internationale des États-Unis.
Ce recours massif aux drones se fait aux dépens de la souveraineté d’États que les États-Unis prétendent restaurer tandis que les innombrables victimes civiles collatérales des frappes témoignent d’un aveuglement technologique de la puissance impériale. De façon symbolique, la dernière opération militaire menée à Kaboul par l’administration Biden le 29 août 2021, avant le retrait d’Afghanistan, était une frappe de drone contre une présumée cellule terroriste de l’État islamique en Afghanistan. Elle tua dix civils innocents à cause d’une erreur d’analyse du renseignement.
Mais l’épuisement hégémonique de la démocratie américaine est aussi intérieur. Quand FDR jetait les bases d’un gouvernement américain du monde lors de la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis incarnaient une puissance jeune, en croissance démographique rapide — la population du pays avait doublé entre les recensements de 1910 et 1960. De très nombreux immigrants sur la période 1870-1920 avaient poursuivi la promesse du rêve américain pressenti par Tocqueville au XIXe siècle : l’accession par la liberté individuelle et la consommation matérielle à un meilleur statut social. Or, la démographie des États-Unis, longtemps atypique vis-à-vis des autres grandes démocraties industrialisées par la vitalité de son solde naturel, connaît depuis le début du XXIe siècle un vieillissement marqué : l’âge médian de la population américaine est passé de 32,9 ans en 1990 à 38,3 ans en 2020.
Et par ailleurs, le prix Nobel d’économie Angus Deaton a remarqué avec sa collègue Ann Case (Morts de désespoir, l’avenir du capitalisme, 2021) le regain depuis 2000 de la mortalité parmi la population blanche âgée de 45 à 54 ans aux États-Unis, contraire à toutes les évolutions constatées dans les grands pays industrialisés.
Cela aurait fini par entraîner depuis 2012, selon les mêmes auteurs, une baisse de l’espérance de vie à la naissance, puis à l’âge adulte, se concentrant parmi la population adulte américaine non diplômée.
Cette évolution démographique souligne les conséquences profondes de l’inégalité croissante des revenus et des fortunes aux États-Unis qui remet en cause la promesse fondatrice du rêve américain. Les États-Unis appuyaient leur revendication hégémonique depuis 1945 sur les bienfaits de leur démocratie consumériste qu’ils entendaient diffuser par la globalisation. Mais cette globalisation a rendu leur démocratie incapable d’assurer l’égalité des conditions entre Américains. Les 1 % les plus riches de la population étasunienne détiendraient en 2021 une fortune équivalente à celle des 90 % les plus pauvres. Cette inégalité enracinée dans la société étasunienne se répercute même dans la projection militaire des États-Unis à l’extérieur. Comme le fait remarquer justement Andrew Bacevich (The age of illusions, 2019), les vétérans des forces armées sont quasi-absents des grandes universités formatrices des élites étasuniennes comme Harvard, Princeton et Yale, montrant un lien rompu entre ceux qui font la guerre, recrutés en majorité parmi les non-diplômés et ceux devant la diriger.
Le projet commun d’expansion démocratique ne semble plus assumé par toutes les parties de la nation américaine. Et cette désunion se reflète aujourd’hui dans le débat politique. Donald Trump a transformé les républicains en un parti soucieux de mettre la toute-puissance militaire des États-Unis au service des seuls intérêts nationaux stricts et d’abandonner le multilatéralisme démocratique. Joe Biden a été élu au contraire en 2020 sur la promesse d’un retour des États-Unis comme première des démocraties, mais appelant ses alliés traditionnels à assumer leur part du fardeau de l’ordre mondial. Comme il le déclarait en février 2021, semblant rompre définitivement avec le messianisme américain, « We can’t do it alone» (Nous ne pouvons pas le faire seuls).