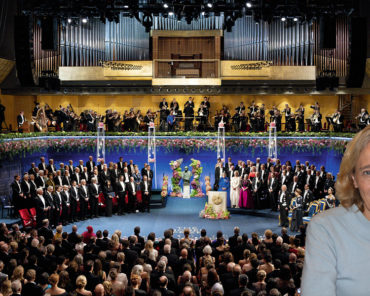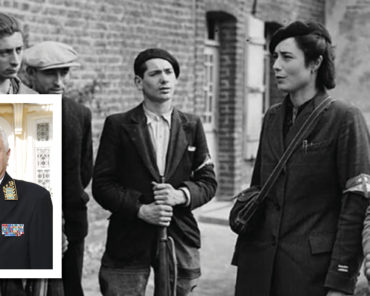L’auteur affronte ce sujet sensible avec une honnêteté intellectuelle jamais prise en défaut et une érudition qui tend à l’exhaustivité. Difficile de résumer en quelques pages un ouvrage aussi dense. Dubois commence par rappeler plusieurs caractéristiques de cette « perle » coloniale avant que l’insurrection ne modifie l’histoire de l’esclavage, l’histoire de France et celle de l’humanité tout entière.
En 1789, Saint-Domingue comptait 465 000 esclaves, 31 000 blancs et 28 000 libres de couleur (noirs et métis non esclaves). Malgré le régime de l’Exclusif, qui obligeait la colonie à ne commercer qu’avec des navires battant pavillon français, la contrebande régnait en maître. Les marchands américains, anglais ou hollandais troquaient des esclaves contre du rhum, du sucre, du café ou de l’indigo. La société insulaire était bien différenciée, les planteurs se caractérisant par une farouche indépendance à l’égard des magistrats. Les créoles, d’origines européenne ou africaine formaient une communauté bien distincte de ce que l’on pouvait observer en France, constituée d’une « faible minorité entourée d’une très vaste population avec ses intérêts propres et sa propre vision du monde ». C’est ainsi que les esclaves ne concédaient le statut de vrais blancs qu’aux grands propriétaires. Les autres, sans terres, n’étaient pour eux que des « petits blancs ». Une société bien stratifiée, donc, qui n’allait pas tarder à voler en éclats.
Tous les propriétaires n’habitaient pas forcément sur leurs plantations. Ils déléguaient leurs pouvoirs à des gérants qui faisaient souvent preuve d’une brutalité n’ayant d’égale que leur malhonnêteté. Sous leurs ordres,
Ajoutons un dernier commentaire pour saluer la traduction de Thomas Van Ruymbeke qui donne au texte de Dubois une dimension épique. En résumé, un très grand livre… »
Laurent Dubois, « Les Vengeurs du Nouveau Monde. Histoire de la révolution haïtienne », trad. par Thomas Van Ruymbeke, éditions les Perséides, Rennes, mai 2022, 515 p.