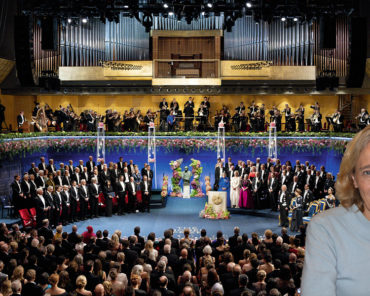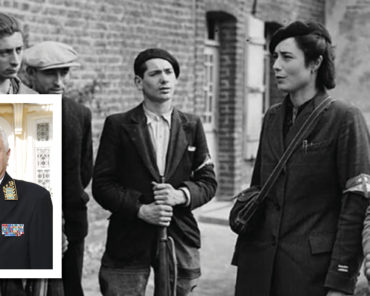En 1989, Mgr Jean-Marie Lustiger, cardinal-archevêque de Paris, justifiait dans une tribune du « Monde » son refus de s’associer aux cérémonies officielles du bicentenaire de la Révolution française : celle-ci n’avait-elle pas été dirigée contre l’Église de France ? Et trois ans plus tard, il organisait une cérémonie religieuse en mémoire des victimes des « massacres de septembre », dont bon nombre étaient des prêtres. Près de vingt après, en 2008, un dignitaire socialiste, Vincent Peillon, est venu justifier l’analyse de Mgr Lustiger dans un livre intitulé « La Révolution n’est pas terminée ». Pas terminée, écrit-il, parce que les valeurs du catholicisme n’ont pas pu être éradiquées (au sens étymologique d’« usque radicem », jusqu’à la racine) et qu’elles sont encore vivaces. « On ne pourra pas constituer un pays de liberté avec la religion catholique », proclame Peillon. « Il faut remplacer ça », poursuit-il : « Comme on ne peut plus acclimater le protestantisme en France, il faut inventer une religion républicaine. »Et il ajoute par ailleurs : « La franc-maçonnerie est la religion de la République. »
En 1789, l’Église de France exerce dans le royaume une influence considérable, à travers ses 135 archevêques et évêques, ses 18 000 chanoines diocésains, ses 50 000 prêtres de paroisse, ses centaines de congrégations religieuses, sa position de principal propriétaire foncier (10 % des terres). L’Église catholique, Église militante qui a connu un nouvel essor dans la foulée de la réforme tridentine,