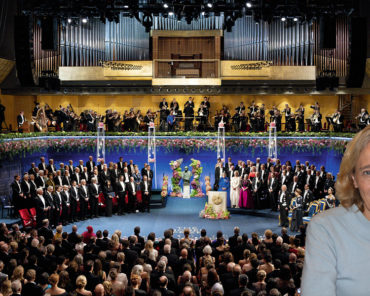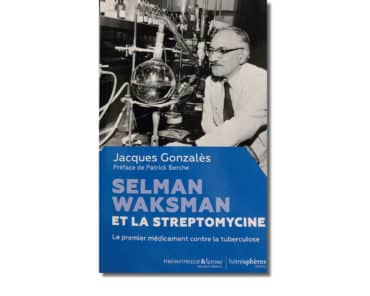par Pascal-Marie Lesbats, historien du cinéma.
A la différence du cinéma d’Hollywood, les films tournés sur la Seconde Guerre mondiale dans les pays vaincus (Italie, Allemagne, Japon) sont méconnus. Pourtant, davantage que la période historique qu’ils décrivent, leur étude fournit des enseignements précieux sur l’époque à laquelle ils ont été tournés.
L’étude du cinéma italien, allemand et japonais révèle des constantes. Avant même l’arrivée au pouvoir de ces régimes totalitaires, des films prônant le patriotisme ou le militarisme étaient déjà produits dans ces pays. Pendant la guerre, l’industrie cinématographique a été utilisée, avec plus ou moins d’insistance, comme outil de propagande. Puis, après la défaite, des films ont exalté la résistance (Allemagne et Italie) ou la paix (Japon), invitant le public à faire son examen de conscience.Seul le Japon, depuis peu, exalte la bravoure de l’Armée impériale pendant les combats de la guerre du Pacifique.
L’Italie : de l’éloge de la résistance à la dénonciation du fascisme.
C ’est en Italie qu’est née l’industrie cinématographique, avant les États-Unis ou la France. La première grande production italienne, La prise de Rome, en 1905, de Filoteo Alberini, célèbre les évènements de 1870 et la naissance de la nation. Les films historiques prônent ainsi l’identité nationale à travers des personnages célèbres (Spartacus, Jules César…) Avant même l’avènement du fascisme, de nombreux films italiens préparent l’idée de créer en Afrique un empire colonial (Le Cid de Mario Caserini en 1910, Le Siège de Burgos de Giuseppe de Liguoro en 1911…). Encouragé par le succès commercial de La chute de Troie en 1911, Giovanni Pastrone réalise Cabiria en 1914, avec l’aide du célèbre poète nationaliste Gabriele D’Annunzio. Après la marche sur Rome (28 octobre 1922), comme toutes les dictatures de la première moitié du XXe siècle, le fascisme fait du cinéma une pièce maîtresse de sa propagande1. Parmi les principaux films de propagande, on peut citer Camicia nera (1933) de Giovacchino Forzano, Vecchia guardia (1934) d’Alessandro Blasetti, L’escadron blanc (1936) d’Augusto Genina, Condottieri (1937) de Luis Trenker et Luciano Serra pilota (1938) de Goffredo Alessandrini. À partir de 1940 sont tournés de nombreux films de guerre par de grands réalisateurs italiens2. Deux films sortis en 1942 décrivent bien sûr la campagne de Lybie : Giarabub de Goffredo Alessandrini et Bengasi d’Augusto Genina. D’autres films de guerre italiens réussis exaltent la guerre sous-marine : S.O.S. 103 (Francesco De Robertis, 1941) et Alpha Tau ! (Francesco De Robertis, 1942). Certains font l’éloge des « amis » allemands (Odessa in Flames, Carmine Gallone, 1942) et espagnols (Les Cadets de l’Alcazar, Augusto Genina, 1940). Brillant réalisateur italien, Roberto Rossellini débute sa carrière pendant la Seconde Guerre mondiale. Ami de Vittorio Mussolini, fils du Duce, il tourne alors une « trilogie fasciste » (Le navire blanc en 1941, Un pilote revient en 1942, L’homme à la croix en 1943) .
Après la chute du régime fasciste, il n’y a pas de véritable épuration dans le monde du cinéma. Les cinéastes se mettent alors à défendre l’idéal démocratique. L’Italie produit de nombreux films sur la Seconde Guerre mondiale, mais très peu de films de guerre. Les rares films de guerre italiens ne sont pas restés dans les annales, comme La Bataille d’El Alamein (Giorgio Ferroni, 1969) ou El Alamein (Enzo Monteleone, 2002).
Plutôt que de dénoncer le régime fasciste, les premiers films sortis exaltent la résistance italienne contre les nazis, à partir de la chute de Mussolini, en 1943. Les plus connus restent ceux de Roberto Rossellini. À la Libération de l’Italie, celui-ci réalise une « trilogie antifasciste » (Rome ville ouverte en 1945, Païsa en 1946, Allemagne année zéro en 1948). Rome ville ouverte (Roma città aperta) est sans doute le premier film réalisé sur la seconde guerre mondiale par un pays vaincu. Peu de films ont joué un rôle aussi important dans l’histoire du cinéma puisque celui-ci marque les débuts du mouvement du néoréalisme. Son aspect réaliste et quasi documentaire est à l’époque novateur. Tourné peu après les évènements qu’il décrit, ce film est également témoin de son époque. Il raconte la résistance d’un groupe d’Italiens qui représentent le peuple : une mère et son fils, un imprimeur, un communiste et un prêtre catholique. Trente ans plus tard, à la fin de sa carrière, Rossellini tourne Anno Uno (1974), qui décrit la chute du fascisme et l’avènement de la démocratie chrétienne italienne.
Par la suite, des films dénoncent le régime fasciste, mais d’abord sur un mode burlesque. Dans La Grande pagaille (1961), Luigi Comencini traite l’armistice du 8 septembre 1943 sur un mode plutôt comique. L’année suivante, Dino Risi, dans La Marche sur Rome (1962), se moque de cet acte fondateur du fascisme. L’objectif de ces films est alors de faire rire le peuple italien par une caricature de certaines pratiques grotesques du régime fasciste.
Puis la critique du régime fasciste devient éminemment politique. Presque tous les grands réalisateurs italiens, qu’ils soutiennent la démocratie chrétienne ou le parti communiste, participent à ce mouvement. En 1960 sort Kapo du cinéaste italien marxiste Gillo Pontecorvo, première fiction d’Europe de l’Ouest sur le génocide. Ce film montre que, dans les camps, des détenus sont devenus complices de leurs bourreaux. En 1969, Luchino Visconti, dans Les Damnés, dénonce la perversion du régime national-socialiste allemand. En 1970, Vittorio De Sica dans Le Jardin des Finzi Contini montre la répression dont sont victimes les juifs de la ville de Ferrare. Cette même année, Bernardo Bertolucci dans Le Conformiste imagine que le personnage principal, pour fuir le souvenir humiliant du viol qu’il a subi, adhère au fascisme et participe au meurtre de son ancien professeur s’opposant au régime. Amarcord (1973), seul film politique de Federico Fellini, dans une chronique de l’Italie campagnarde et fasciste, dévoile la brutalité des manifestations du nouveau régime. En 1975, Salò ou les 120 Journées de Sodome, tourné par Pier Paolo Pasolini juste avant son assassinat, propose dans le cadre de la République sociale italienne une éprouvante descente dans la perversité sexuelle. En 1976, Bernardo Bertolucci critique de nouveau le fascisme dans sa fresque 1900. Dans Une journée particulière (1977), Ettore Scola dénonce le système patriarcal et homophobe du régime fasciste. En 1979, dans Le Christ s’est arrêté à Eboli, Francesco Rosi raconte l’exil d’un opposant au fascisme dans un village perdu de Lucanie. Dans La Nuit de San Lorenzo (1982), Paolo et Vittorio Taviani évoquent le sort de villageois en juillet 1944 : les uns sont massacrés dans l’église par les nazis, les autres se battent aux côtés de la Résistance contre les fascistes. N’oublions pas non plus l’œuvre du cinéaste communiste Carlo Lizzani, qui a consacré nombre de ses films à la dénonciation du fascisme, de Achtung! Banditi ! (1951) à Les Derniers Jours de Mussolini (1974). La vie est belle de Roberto Benigni tente en 1997 de retrouver les ressorts de la comédie pour traiter de la barbarie nazie. Il fut reproché à Benigni d’avoir voulu faire rire du génocide. En réalisant Vincere en 2009, le cinéaste italien Marco Bellocchio signe une œuvre magistrale sur l’expansion du fascisme. Il commence par présenter l’énergie débordante du jeune Benito Mussolini. C’est l’occasion de rappeler son passé socialiste. Puis on découvre la terrible condition d’une femme séquestrée par un régime autoritaire.
L’étude du cinéma italien révèle ainsi que l’Italie de l’après-guerre s’est bâtie sur les idéaux de l’antifascisme et de la Résistance. Il s’agit d’un cinéma politique, les films de guerre italiens restant rares.
L’Allemagne : de l’éloge de la résistance à la honte du nazisme.
C ’est au cours des années 1920 que va naître la période cinématographique la plus prolifique de l’Allemagne. L’esthétisme sombre de ce courant expressionniste allemand, dont les chefs de file sont Friedrich Wilhelm Murnau et Fritz Lang, semble illustrer la psychologie d’une nation traumatisée par la défaite de 1918. Au cours des années 1930, les thèmes évoqués dans des films aujourd’hui tombés dans l’oubli sont parfois ceux du nazisme : la gloire militaire (Kreuzer Emden de Louis Ralph en 1927, Tannenberg de Heinz Paul en 1932) et la notion de sacrifice (L’Aube de Gustav Ucicky en 1933).
En 1933, à l’arrivée au pouvoir du national-socialisme, Joseph Goebbels, ministre de l’Information et de la Propagande, s’intéresse au cinéma comme instrument de propagande. Dès 1934, la projection de chaque film doit être précédée par celle d’un documentaire qui vante les mérites du nouveau régime. En 1934, Leni Riefenstahl filme le congrès de Nuremberg dans Le Triomphe de la volonté, puis, en 1936, les Jeux olympiques de Berlin dans Les Dieux du stade (Olympia). Des fictions distillent un discours de propagande d’esprit militariste : S. A. Mann Brand (1933) de Franz Seitz senior et Le Jeune Hitlérien Quex (1933) de Hans Steinhoff. Contrairement à une idée répandue, pendant la guerre, les films de propagande ne représentent qu’une infime partie de la production cinématographique du IIIe Reich. Sur les 1350 longs-métrages produits entre 1933 et 1945, il y a 1200 divertissements. Beaucoup sont des films musicaux contenant des numéros de cabaret. Goebbels sait en effet que le public se désintéresse des films marqués idéologiquement. En réalité, la propagande est le plus souvent limitée aux actualités et aux documentaires. Quelques films de guerre et de propagande exaltent pourtant le nationalisme et la guerre . Sous-marins, vers l’Ouest ! (U-Boot westwärts!) de Günther Rittau vante en 1941 les exploits et le sens du sacrifice des marins allemands. Dans Stukas (1941) de Karl Ritter, spécialiste des films d’aviation, un jeune officier de la Lutwaffe, blessé, redécouvre le sens du combat en écoutant Wagner à Bayreuth et retourne enthousiaste au front. Tourné en 1942, GPU de Karl Ritter critique les manœuvres des services secrets soviétiques à la veille de la guerre.
En 1945, la guerre laisse une Allemagne en ruines. Elle est divisée en deux secteurs d’occupation militaire, qui deviennent deux États distincts jusqu’en 1990. Que le cinéma allemand soit sous domination soviétique (à l’est) ou américaine (à l’ouest), l’objectif est de dénazifier.
À l’est, le cinéma d’après-guerre dénonce le nazisme. Dans Les assassins sont parmi nous (1946), premier film allemand de l’après-guerre, Wolfgang Staudte dans Berlin ravagé par les bombardements traite de la culpabilité individuelle et collective. Mariage dans l’ombre (1947) de Kurt Maetzig est le premier film à confronter le peuple allemand à la persécution des juifs.
« À partir des années 1950, sans doute en raison de la guerre froide, de nombreux films tournés en Allemagne de l’Ouest s’attachent ainsi à dédouaner l’armée allemande des crimes nazis. »
à l’ouest, placé sous la responsabilité de l’Office of War Information, le cinéma cherche à rééduquer les Allemands dans un idéal démocratique. Tout réalisateur allemand, pour tourner un film, doit répondre à un questionnaire sur ses opinions politiques. Des documentaires sur les camps de concentration sont également diffusés. Mais le cinéma de l’Allemagne de l’Ouest ne s’interroge pas véritablement sur la responsabilité du peuple allemand, comme si seul Hitler avait décidé de tout.
À partir des années 1950, sans doute en raison de la guerre froide, de nombreux films tournés en Allemagne de l’Ouest s’attachent ainsi à dédouaner l’armée allemande des crimes nazis. Sont ainsi régulièrement mis en avant les résistants au nazisme. L’Amiral Canaris (1954) d’Alfred Weidenmann révèle que le responsable de l’Abwehr (service de renseignement de l’armée allemande) s’oppose secrètement à la politique nazie. C’est arrivé le 20 juillet réalisé par Georg Wilhelm Pabst en 1955 décrit l’attentat du 20 juillet 1944 perpétré par Claus von Stauffenberg contre Hitler. Le général du diable, réalisé en 1955 par Helmut Käutner, dresse le portrait d’un général de la Luftwaffe, qui accomplit son devoir d’officier tout en critiquant le régime hitlérien. Ce film soigné rappelle que toute l’armée allemande n’a pas suivi aveuglément Hitler dans ses rêves de conquête. Dans le Neuvième jour (2004), Volker Schlöndorff s’inspire de l’histoire de l’abbé Jean Bernard pour montrer comment la foi chrétienne a permis à certains de résister à l’idéologie nazie. Le mouvement de résistance chrétien la Rose blanche et le parcours de Sophie Scholl ont fait l’objet de plusieurs films : La Rose blanche (1982) de Michael Verhoeven et Sophie Scholl : Les Derniers Jours (2005) de Marc Rothemund. Ce dernier film retrace la vie de cette célèbre résistante au nazisme. L’enquêteur de la Gestapo et Sophie Scholl confrontent leurs points de vue sur le sens national, le respect du droit et la conscience individuelle. Il en résulte une critique originale du national-socialisme fondée sur le sens chrétien de la compassion. Enfin, le film John Rabe (2009) de Florian Gallenberger célèbre, même s’il appartenait au parti nazi, le rôle joué par un homme d’affaires allemand qui protégea les habitants de Nankin lors du massacre de 1937 perpétré par l’Armée impériale japonaise. Il dévoile toutes les exactions commises par l’armée japonaise, notamment un concours de décapitation !
« Dans un autre chef-d’œuvre, Le bateau (Das boot), le cinéaste Wolfgang Petersen parvient en 1981 à reproduire avec réalisme la camaraderie, le sens du devoir et le courage des sous-mariniers. Ce film traduit bien l’esprit d’indépendance de la kriegsmarine pendant le IIIe Reich. »
à l’inverse de l’Italie, plusieurs films de guerre ont été produits par ce pays vaincu. Méconnue en France, la trilogie 08/15 tournée en 1954 par Paul May, avec un scénario d’Ernst von Salomon adaptant le roman de Hans Hellmut Kirst, ancien officier de la Wehrmacht, décrit les vicissitudes de la vie du soldat allemand pendant la Seconde Guerre mondiale. En 1959, Chiens, à vous de crever ! de Frank Wisbar montre, avec des moyens relativement modestes, qu’au cours de la bataille de Stalingrad les soldats privés de tout prennent conscience de la folie mégalomane du Führer. Le Pont (1959) de Bernard Wicki décrit les derniers jours d’avril 1945, dans une petite ville allemande. Convaincus de défendre la cause de leur peuple, mais sans aucune formation militaire, des collégiens affectés à la défense du pont de leur ville vont affronter les chars américains ! Ils sont victimes d’un régime moribond qui se sert de leur ferveur insouciante. Dans un autre chef-d’œuvre, Le bateau (Das boot), le cinéaste Wolfgang Petersen parvient en 1981 à reproduire avec réalisme la camaraderie, le sens du devoir et le courage des sous-mariniers. Ce film traduit bien l’esprit d’indépendance de la kriegsmarine pendant le IIIe Reich. Réalisé en 1993 par Joseph Vilsmaier. Stalingrad suit le terrible parcours d’une unité de la Wehrmacht dans un enfer d’acier, de feu et de sang. Vilsmaier ne reconstitue pas l’historique de la bataille, mais s’intéresse aux soldats, à leur courage, à leurs craintes, leurs doutes. Dans cette série, Der Stern von Afrika (1957) d’Alfred Weidenmann, en faisant l’apologie d’un as de la Luftwaffe, malgré les coupes du ministère de la Défense craignant une propagande nazie, constitue une curiosité.
« ”La Chute” d’Oliver Hirschbiegel (2004) décrit les derniers jours d’Hitler et du IIIe Reich durant la bataille de Berlin, en avril 1945… Ce chef-d’œuvre a suscité une polémique, certains critiquant une humanisation d’Hitler dans des scènes de la vie quotidienne. »
Les films dénonçant le nazisme sont moins nombreux qu’on pourrait le croire. Dans Le Mariage de Maria Braun (1978), Rainer Werner Fassbinder s’interroge sur la culpabilité des générations d’Allemands qui ont soutenu le nazisme et révèle la réalité allemande de l’immédiat après-guerre : on marchande ses bijoux contre un paquet de cigarettes. Dans Le Tambour, réalisé par Volker Schlöndorff en 1979, un petit garçon refuse de grandir sous le régime nazi. Ce film obtient la Palme d’Or du Festival de Cannes. Le film Napola (2004) de Dennis Gansel, en dévoilant le régime des écoles de l’élite nazie, offre un drame psychologique intense. Les Faussaires de Stefan Ruzowitzky (2007) décrit l’opération Bernhard visant à déstabiliser l’économie britannique en l’inondant de fausses livres sterling. On découvre le dilemme des prisonniers, certains travaillant de leur mieux pour tenter de survivre, d’autres ralentissant la production afin de soulager leur conscience. Mais le film de réflexion le plus intéressant sur le nazisme est sans doute Hannah Arendt, réalisé en 2013 par Margarethe von Trotta. Philosophe américaine juive d’origine allemande, Hannah Arendt a fui l’Allemagne nazie en 1933. Elle va couvrir, pour un journal, le procès d’Adolf Eichmann, responsable de la déportation de millions de Juifs vers les camps d’extermination. Sa théorie de La banalité du mal déclenche une forte controverse. Elle explique avoir découvert, dans sa cage en verre, un homme dépourvu de pensée qui ne faisait qu’exécuter les ordres. Considérer l’un des organisateurs de la solution finale comme un simple exécutant provoque alors une vive controverse.
Comment le cinéma allemand a-t-il représenté Hitler au cinéma ? Davantage connu que La Fin d’Hitler (1955), film austro-allemand de Georg Wilhelm Pabst, La Chute d’Oliver Hirschbiegel (2004) décrit les derniers jours d’Hitler et du IIIe Reich durant la bataille de Berlin, en avril 1945. Le producteur et scénariste Bernd Eichinger le présente comme « un film allemand, réalisé avec des moyens allemands, des techniciens allemands, des acteurs allemands, pour un public allemand ». Ce chef-d’œuvre a suscité une polémique, certains critiquant une humanisation d’Hitler dans des scènes de la vie quotidienne. Peu de temps après naît une nouvelle polémique, à la sortie du film comique Mon führer (2007). Le réalisateur suisse Dani Levy imagine qu’en décembre 1944, Goebbels charge un metteur en scène juif de remettre sur pied un führer en pleine déprime, afin de prononcer un grand discours pour galvaniser les masses. En montrant l’intimité d’Hitler, Levy dépeint un dictateur colérique et sensible. Il se justifie en rappelant que « la comédie est plus subversive que la tragédie ».
Le Japon : du pacifisme au renouveau patriotique.
Dès la guerre russo-japonaise (1904-1905), l’industrie cinématographique japonaise envoie des caméras sur les champs de bataille pour stimuler le sentiment national. Dans les années 1920 et 1930, le patriotisme nippon apparaît dans les premiers films de samouraïs et dans des films de guerre. En 1931, le Japon envahit la Mandchourie. Les films d’esprit militariste se développent. Le Japon attaque la Chine en 1937. Le gouvernement incite alors le cinéma à privilégier l’autorité, la tradition familiale et l’esprit de sacrifice.
Certes, les films de guerre japonais sont pour la plupart réalistes et montrent la souffrance des soldats. Mais dans la culture japonaise de l’époque, la souffrance d’un soldat atteste de son sacrifice envers l’Empereur. Tomotaka Tasaka réalise ses chefs-d’œuvre décrivant avec réalisme les souffrances de la guerre tout en exaltant le militarisme : Les Cinq éclaireurs (1938), Terres et soldats (1939)… Avec le bombardement de Pearl Harbor, le 7 décembre 1941, le Japon accentue le contrôle de l’État. Contrairement à l’Allemagne, le cinéma ne se tourne pas en pleine guerre vers l’amusement du peuple. Tous les genres contribuent à la propagande. De grands cinéastes appellent à la poursuite des efforts : Yasujirō Ozu tourne en 1942 Il était un père, qui décrit un père ayant un sens élevé de ses responsabilités. Akira Kurosawa dans Le Plus beau (1944) dévoile les efforts des ouvrières japonaises pour produire des armes. Keisuke Kinoshita tourne L’Armée (1944), faisant l’éloge de la fidélité à l’Empereur tout en montrant l’inquiétude d’une mère pour son fils. Parmi les plus beaux films de guerre, on trouve, de Kajiro Yamamoto, une trilogie à la gloire de l’aéronavale japonaise : La Bataille navale à Hawaï et au large de la Malaisie (1942), L’escadrille des faucons de Kato (1944) et En avant les escadrons de torpilleurs ! (1944).
Après la défaite du Japon commence une épuration cinématographique. Les autorités d’occupation américaines détruisent la moitié des films de guerre, interdisent la production de sujets d’actualité pendant deux ans et dressent une liste des criminels de guerre du cinéma. Pour éviter que le Japon ne redevienne une menace est ainsi créée la Direction de l’information et de l’Éducation civique, laquelle contrôle l’industrie cinématographique et dresse une liste de sujets interdits : militarisme, nationalisme, idée de revanche, éloge de la loyauté de type féodal… On renonce alors à tourner des films de samouraïs.
« Les années soixante sont pour le Japon une période de contestation de la tradition. Plusieurs réalisateurs dénoncent le bushido dans les films de samouraïs, ou le militarisme dans des films de guerre.»
Ainsi Kurosawa tourne dès 1946 Je ne regrette rien de ma jeunesse, film antimilitariste. Kinoshita est forcé pas la censure américaine de montrer la lâcheté des officiers dans Le Matin de la famille Osone (1946). Le cinéma japonais acquiert après la guerre une reconnaissance internationale. Le film de sabre renaît grâce à Akira Kurosawa (Rashōmon en 1951 et Les Sept Samouraïs en 1954).
En 1952 cesse l’occupation du Japon par les Américains. Certes, les films antimilitaristes ou humanistes restent nombreux. L’un des plus grands succès de l’après-guerre est La Tour des Lis (1953), de Tadashi Imaï, qui évoque le sacrifice, sous un tapis de bombes, d’étudiantes enrôlées à Okinawa comme infirmières au service de l’Armée japonaise. Dans La harpe de Birmanie (1954), Kon Ichikawa imagine qu’après la capitulation un soldat errant devient moine bouddhiste. Puis, dans Feux dans la plaine (1960), chef-d’œuvre de réalisme, Ichikawa imagine le terrifiant parcours d’un soldat atteint de la tuberculose. Sont également tournés des films dénonçant les bombardements atomiques : Les enfants d’Hiroshima (1953) de Kaneto Shindo, Hiroshima de Hideo Sekigawa (1953)…. Mais à cette époque sont de nouveau réalisés des films de guerre nostalgiques de l’exaltation militaire tels que Cuirassé Yamato de Yutaka Abe (1953), L’aigle du pacifique de Ishiro Honda 1953, Yamashita Tomoyuki, un général tragique (1954) de Kiyoshi Saeki. Les années soixante sont pour le Japon une période de contestation de la tradition. Plusieurs réalisateurs dénoncent le bushido dans les films de samouraïs, ou le militarisme dans des films de guerre. Kihachi Okamoto dénonce le sacrifice des kamikazes dans La bombe humaine (1968) et l’horreur de la guerre dans La bataille d’Okinawa (1971). Dans Zero pilot (1976), Seiji Maruyama décrit le parcours d’un pilote japonais en révélant ses critiques envers la politique nipponne. C’est au cours de cette période qu’est tournée la co-production américano-nipponne Tora ! Tora ! Tora ! (1971), célèbre film sur l’attaque de Pearl Harbor ménageant les susceptibilités des deux camps. Les séquences japonaises initialement confiées à Kurosawa, finalement réalisées par Kinji Fukasaku et Toshio Masuda, sont les plus réussies, à l’image de celle représentant le décollage à l’aube des avions japonais. Furyo, réalisé en 1982 par Nagisa Oshima, dénonce le code de l’honneur très strict du bushido dans un camp de prisonniers anglais. Les films dénonçant les bombardements nucléaires ou incendiaires ne cessent pas : Les enfants de Nagasaki (1983) de Kinoshita, Le Tombeau des lucioles (1988) d’Isao Takahata, Pluie noire (1989) de Shōhei Imamura, Rhapsodie en août (1991) de Kurusowa… L’objectif est de montrer l’horreur de l’arme nucléaire.
Au cours des années 2000, le cinéma de guerre patriotique est de retour. Certes, certains films continuent de dénoncer le patriotisme, comme Le Soldat dieu (2010) de Kōji Wakamatsu, qui décrit le retour dans sa famille d’un lieutenant, couvert de médailles, mais ayant perdu ses bras et ses jambes au combat. Mais dans Les hommes du Yamato (2005), en décrivant les derniers jours du célèbre cuirassé coulé le 7 avril 1945, Jun’ya Sato met l’accent sur le comportement héroïque des marins morts pour défendre leur patrie. Le cinéma japonais récent glorifie également le sacrifice des kamikazes. Kamikaze assaut dans le pacifique (2007), insiste sur la psychologie de différents pilotes : celui qui s’en veut d’avoir échoué et d’être revenu vivant, le Coréen qui souhaite mourir pour l’Empereur du Japon… Il glorifie bien sûr celui qui écrase son zéro sur un porte-avions. Le réalisateur Taku Shinjo, qui se défend d’avoir fait œuvre de propagande, a voulu « dépeindre de jeunes gens qui se sacrifièrent pour défendre leur pays ». Cette reconstitution prône le retour aux valeurs traditionnelles et insiste sur le sens de l’honneur des militaires nippons, du général au simple pilote. Dans la même veine, Kamikaze, le dernier assaut, tourné par Takashi Yamazaki en 2013, montre que les kamikazes souhaitent mourir glorieusement pour leur pays. 1945 End of war de Hideyuki Hirayama décrit en 2011 la guérilla menée par des soldats nippons, héroïques et désireux de protéger les civils japonais, qui continuent à se battre contre l’armée américaine après la fin de la guerre. •