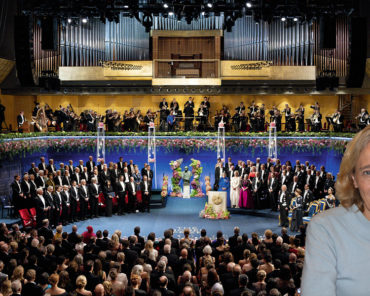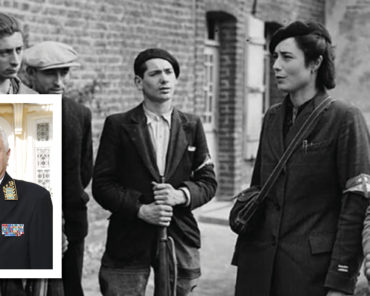Dans un ouvrage qui vient de paraître, Emmanuel de Waresquiel se penche sur les mémoires et les héritages de la Révolution française. Il analyse avec brio, tel un « mécanicien » les
déformations et les évolutions à travers deux siècles de notre histoire des évènements érigés en symboles. Entretien …
La Révolution française est présente aujourd’hui moins par son histoire, par les faits historiques que par les représentations que l’on en a faites au fil du temps. Les symboles et les représentations de la Révolution française se sont-ils substitués à l’histoire ?
Emmanuel de Waresquiel : Nos contemporains se promènent dans un champ de ruines et n’y font guère attention. Ils se sont assis sur leur histoire au point d’en avoir oublié la genèse et les commencements. Tout les y invite : l’urgence, la vitesse, Internet, les portables, l’information. Le temps s’est comme replié sur lui-même. Il s’est changé en une succession d’instants sans solution de continuité. Les évènements les plus récents chassent les précédents. Il en va de même des mémoires révolutionnaires. Les discours, les monuments qu’elle nous a légués ne disent pas ce qu’elle a été, mais ce que ses acteurs et leurs successeurs, d’une république à l’autre, ont voulu que nous en retenions. Nous avons une appétence particulière pour les symboles, les signes, les célébrations. Victor Hugo le dit très bien en 1878 : « Les grandes dates évoquent les grandes mémoires. À de certaines heures, les glorieux souvenirs sont de droit. » Les pères de la IIIe République ont passé leur temps à peupler les places et les rues de nos villes de monuments et de statues — que l’on déboulonne un peu ces temps-ci :