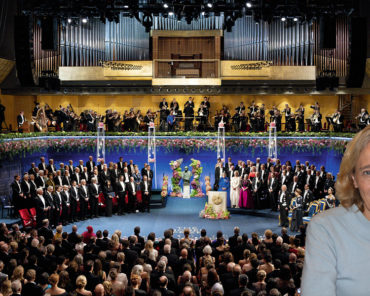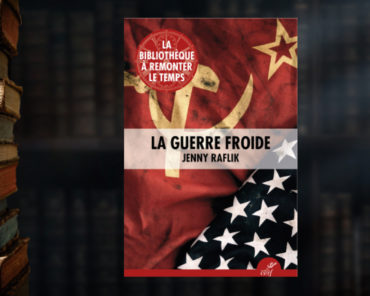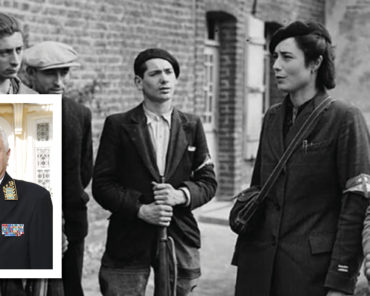Pourquoi fêtons-nous Noël et depuis quand ? Quels sens accorder à la crèche, au sapin, à la bûche, aux cadeaux ou bien aux rennes… ? À ces questions et à une multitude d’autres, Noël, toute une histoire, vous permettra de répondre. En effet, fidèle à sa méthode, qui consiste à étudier un phénomène dans sa totalité et sur le temps long, Olivier Grenouilleau (de l’Institut) nous impressionne. Car rien ne va de soi, dans l’affaire, montre-t-il. Deux exemples suffiront ici.
Le premier a de quoi surprendre. Noël est avant tout, jusqu’à une date assez récente, essentiellement la fête de la Nativité du Christ. Il faut pourtant attendre le IVe siècle de notre ère pour qu’elle commence à être officiellement célébrée. Ce qui, alors, incite les théologiens à se demander à quel moment de l’année est précisément né le Christ, question que la plupart d’entre eux considéraient auparavant comme impie. Pourquoi ce changement ? Afin de contrer les fêtes païennes liées au culte solaire, notamment celles en faveur du dieu Mithra, né un 25 décembre, dans une grotte… ? Rien n’est moins sûr nous dit Olivier Grenouilleau. Les chrétiens ne célèbrent pas, en effet, la lumière solaire, mais celle de l’Esprit guidant les fidèles vers le Salut. Une coïncidence, par ailleurs, interroge : la célébration de la Nativité coïncide avec le déclin de celle de la saint Jean-Baptiste et avec le moment où le dogme de la Sainte Trinité est affirmé. Alors que des gnostiques se demandent encore si Jésus est bien divin avant son baptême par saint Jean… La célébration de la Nativité, dans ce contexte, vient à point, en permettant de stabiliser le dogme, au moment où l’Église devient une institution centrée sur Rome.

Le magazine américain Puck du 3 décembre 1902 présente un Père Noël.
Deuxième exemple : saint Nicolas, durant des siècles, fait des miracles. Mais il n’entretient que de lointains rapports avec les enfants et ne distribue pas de cadeaux. Et puis, vers le XIVe siècle, on le voit devenir le patron des « escholiers », les jeunes des chapitres cathédraux. Bizarrement, c’est aussi à ce moment-là que les Fêtes des fous sont interdites, parce que l’on ne tolère plus les débordements de fin d’année de ces jeunes clercs. Dans les campagnes, l’apparition de donateurs surnaturels (car saint Nicolas est loin d’être seul en la matière, en Europe) coïncide avec le recul des bandes de « guisarts », ces jeunes, turbulents et déguisés, qui allaient, de porte-à-porte, quémander de petites pièces ou des friandises à l’occasion des fêtes du renouveau de la lumière. S’agit-il là de simples coïncidences ? Ce qui est sûr est que les donateurs surnaturels instaurent un autre rapport, avec les enfants, lesquels, pris individuellement, ne sont récompensés que s’ils sont sages — sinon, gare, le double maléfique de saint Nicolas veille…
Ces exemples, que l’on pourrait multiplier, soulignent l’intérêt du temps long qui permet de recoller les innombrables pièces du puzzle de Noël. Ce faisant, des coïncidences apparaissent qui interrogent et qui, auparavant, pouvaient passer inaperçues.

Repas de Noël en Europe du Nord au début du XXe siècle dans une famille aisée. illustration de Carl Larsson, 1904-1905
Si, en savant, Olivier Grenouilleau nous apprend beaucoup, en conteur, il sait nous charmer. Car, dit-il, pour comprendre Noël, il faut, « avec bonheur, renouer avec des histoires empruntant à l’anecdotique et au merveilleux ; croiser les apports de folkloristes, d’historiens, d’ethnologues, de sociologues, de psychanalystes ; jongler avec les périodes de l’histoire, le sacré et le profane, le monde des morts et des vivants ; s’intéresser à la manière dont nous avons, à travers les âges, perçu le temps, les cycles de la vie, les fonctions du don et de la fête, le rapport à l’enfance… ». Ajoutons le recours à l’image, dans un ouvrage magnifiquement illustré et mis en page… un cadeau en soi.
Des Anthestéries grecques et des Saturnales romaines au Noël d’aujourd’hui, que de changements ! De ruptures aussi, car la Nativité instaure un cycle nouveau où ce n’est plus l’homme qui sacrifie aux dieux, mais le Divin qui offre son Fils en sacrifice aux hommes. Avec toujours une part de merveilleux. Pratiquement rien ne transpire, dans les Évangiles, au sujet des personnages de la scène noëlique, l’âne et le bœuf, ou bien les rois mages. Il a donc fallu ici ou là inventer, bricoler… De la crèche théâtralisée de saint François d’Assise aux crèches familiales, il y a aussi un pas, énorme.
Tout comme celui franchi avec « l’invention » du Père Noël, à partir de traditions d’Europe, transformées aux États-Unis avant d’être réintroduites dans le Vieux Continent, y remplaçant moult donateurs traditionnels de l’hiver (même si Basile, en Grèce, les rois mages en Espagne, ou bien saint Nicolas demeurent). Un Noël « moderne »
curieux à certains égards. Puisqu’il célèbre le culte de la société de consommation… tout en faisant du cadeau un don gratuit (masqué, le donateur n’attend rien — théoriquement — de son geste, sinon le plaisir de gâter un être cher). Don gratuit que l’on pourrait interpréter comme le moyen de contrer, symboliquement et de manière éphémère, cette même société de consommation…
Olivier Grenouilleau ne nous fait pas seulement rêver en nous instruisant. Avec Noël, toute une histoire, il invite le lecteur au voyage (dans le temps et l’espace, à travers l’ensemble du monde occidental), à décoder la manière dont a évolué notre civilisation, à en comprendre les symboles. Et plus encore…
Un livre à mettre sous tous les sapins.•

Noël. Toute une histoire.
Olivier Grenouilleau. Editions du Cerf.