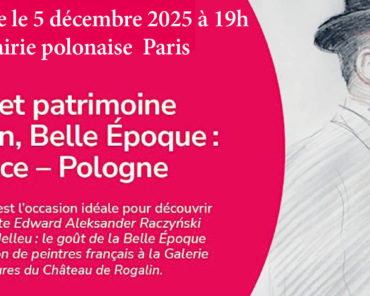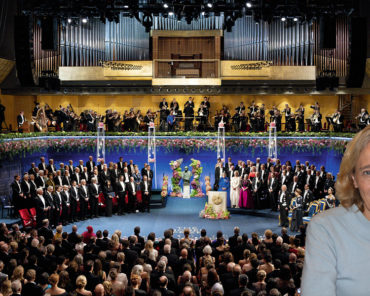À l’orée du XVIème siècle, les Espagnols font main basse sur plusieurs ports algériens et commencent à lorgner l’arrière-pays. Les souverains hafside et zianide, effrayés, composent avec Ferdinand le Catholique et lui payent un tribut. Indignées, les populations entrent en résistance, chauffées à blanc par les soufis, notamment par une thaumaturge kabyle, la légendaire Lella Goureya, qui donne le signal de la guerre sainte. Les révoltés appellent la Sublime Porte à la rescousse. Célèbre corsaire au service des Ottomans, l’aîné des frères Barberousse, Arudj, vient se
battre à leur côté. En 1515, exaspéré par l’émir d’Alger qui fraye avec les Espagnols, il l’assassine et s’intronise sultan de la ville. A sa mort sur le champ de bataille de Tlemcen en 1518, son frère cadet Khairad-Din Barberousse devient sultan à son tour. Mais il estime avoir beaucoup trop d’ennemis, Espagnols, Hafsides de Tunis, ainsi que d’anciens alliés, les Kabyles du royaume de Koukou qui se sont retournés contre lui. Il fait alors allégeance à l’empire ottoman. Le sultan Sélim 1er le nomme berlebey, émir des émirs. L’arrivée de 2000 janissaires et de 4000 soldats dotés d’une artillerie musclée va permettre à Khairad-Din de re- prendre les choses en mains. Après lui, d’autres berlebeys se succéderont à la tête de la Régence, et ce jusqu’en 1587, relayés par des pachas nommés par le sultan turc, eux- mêmes remplacés en 1659 par des aghas, plus indépendants que les pachas, auxquels se substitueront des deys, fruits d’une monarchie élective, qui gouverneront jusqu’en 1830.
Complots, trahisons, exécutions capitales, révoltes, guerres, course barbaresque, l’histoire de la régence d’Alger n’a certes rien d’une berceuse de la bibliothèque rose, mais ni plus ni moins que celles de tous les états dits civilisés.
Napoléon 1er, qui rêvait de mettre en coupe réglée la Méditerranée et l’Afrique du nord, avait dépêché en 1808 un espion à Alger, le commandant Boutin. Après moultes aventures, cet officier du génie était rentré en France. Dans son rapport, il déconseillait formellement d’attaquer la ville fortifiée de façon frontale, préconisant un débarquement sur les plages de Sidi-Ferruch, à 24 km à l’ouest d’Alger. Mais l’empereur ne donna pas suite au projet, trop préoccupé par d’autres rêves de grandeur. Lorsque le 29 avril 1827, le dey d’Alger, Hussein, excédé par la suffisance du consul de France, le gratifia d’un coup de chasse-mouches, on ressortit aussitôt le rapport de Boutin, qui entre-temps était allé se faire tuer par des Alaouites en Syrie. Officiellement, la France se devait de répondre à cet « affront », qualifié d’« inqualifiable ». En réalité, d’autres motifs se profilaient derrière ce graal, redorer le blason du royaume, convertir éventuellement les indigènes, liquider les derniers barbaresques, apporter aux populations locales les délices de la civilisation ainsi que, tant qu’à faire, mettre la main sur le trésor de la Casbah. En conséquence, le 14 juin 1830, 37000 hommes et 3400 montures débarquèrent sur la presqu’île de Sidi-Ferruch. Après deux brèves rencontres le 19 et le 24 à Staoueli, l’armée turque se débanda. Ultime obstacle, le Fort l’Empereur, à l’est d’Alger, fut pilonné le 4 juillet par l’artillerie française. L’estimant indéfendable, les assiégés le firent sauter. Résigné, le dey d’Alger capitula le 5. Ce jour-là, les troupes du général de Bourmont entrèrent à midi dans Alger, en fanfare, sur l’air de « la marche de Moïse » de Rossini. Le dey et ses janissaires furent poliment priés de déguerpir. L’Algérie française venait de naître. Il lui restait 132 ans à vivre, « avant la proclamation d’une indépendance qui l’enverrait au cimetière des colonies ».
Cette épopée, l’excellent historien Jacques Frémeaux nous la raconte sans parti pris, avec un sens de la nuance et du détail qui éclaire chaque phase de la conquête, puis de la colonisation.
Hauts en couleurs sont les personnages qui animent cette fresque. Il y a Abd el- Kader, jeune marabout se disant descendant d’al- Hasan, et donc de Mahomet, élu chef des tribus de l’ouest dès la fin de l’année 1832. Jusqu’à sa reddition en 1847, ce fin stratège courageux et magnanime donnera bien du fil à retordre à l’armée française. Mais l’homme recommandé par Thiers et désigné par Soult pour combattre l’émir récalcitrant ne fit guère dans la dentelle. A partir de 1841, le général Bugeaud, devenu maréchal en 1843, pratiquera à outrance la politique de la terre brûlée. Incendier les villages et les récoltes, emmurer les rebelles et leurs familles dans des grottes, les enfumer comme des renards, autant de bienfaits que les troupes du « père la casquette » prodiguèrent sans réserve à leurs adversaires.
Louis- Philippe ayant été prié de faire ses valises, c’est la Deuxième République qui prit l’initiative d’annexer l’Algérie et de créer, parallèlement aux territoires militaires, trois départements, Alger, Oran et Constantine. Mais il faudra attendre Napoléon III pour que les musulmans d’Algérie aient enfin le sentiment d’avoir un allié au plus haut niveau de l’Etat français. L’empereur ne comptait pas que des amis de ce côté de la Méditerranée, notamment les 10000 opposants qu’il y avait fait déporter après son coup d’état du 2 décembre 1851. Par ailleurs, les colons étaient plutôt favorables aux Républicains, ce qui ne les rendait pas forcément sympathiques aux yeux de leur souverain. Après la conquête de la Grande Kabylie, achevée en 1857, la paix semblant plus ou moins régner, les civils redoublèrent de critiques à l’égard des bureaux arabes, officiellement créés en février 1844. Pour Jacques Frémeaux, « avec une générosité mêlée de paternalisme, mais aussi par souci d’éviter les insurrections qui naissent du désespoir des tribus, les bureaux arabes se font les défenseurs des indigènes, notamment en cherchant à freiner le transfert des terres sous toutes ses formes au profit des Européens. Les colons ripostent en dénonçant le régime despotique et oppressif que, selon eux, les bureaux arabes font peser sur les populations musulmanes, avec la complicité de chefs corrompus ». Parlant couramment l’arabe, les officiers qui dirigeaient ces bureaux s’appuyaient sur un réseau de chefs locaux. Certes, pour capter leur bienveillance, ils les laissaient parfois piocher dans la caisse, leur distribuaient des médailles autant qu’ils en voulaient et finançaient de ci de là une fiesta ou la noce d’un cousin. Mais il faut reconnaître, n’en déplaise aux fans du parti « coloniste », que ces bureaux mettront en œuvre toutes sortes de travaux. Grâce à eux, des routes, des ponts, des barrages, des puits, des infirmeries, des halles, etc., surgiront du sable. Napoléon III voulut en sa- voir plus, et surtout rencontrer les intéressés. Le 17 septembre 1860, il débarqua avec sa femme et le prince impérial à Alger. Si les notables musulmans lui firent une excellente impression, de par leur dignité et leur bonne volonté, en revanche, les colons et fonctionnaires l’agacèrent au plus haut point avec leurs revendications incessantes. Le 19, lors du dîner de départ organisé dans la cour du lycée, il prononça un discours fondateur :
“Napoléon III : « (…) Notre premier devoir est de nous préoccuper du bonheur de trois millions d’Arabes que le sort des armes a fait passer sous notre domination (…) “
Elever les Arabes à la dignité d’hommes libres, répandre sur eux l’instruction tout en respectant leur religion, améliorer leur existence, (…) telle est notre mission : nous n’y faillirons pas ». L’empereur ajoutera cette petite phrase qui ne manquera pas de faire couler de l’encre : « Notre colonie d’Afrique n’est pas une colonie ordinaire, mais un royaume arabe ». Traduite par l’historien, cette expression signifie que l’empereur souhaitait « garantir aux Algériens musulmans, sous le contrôle de l’armée, la perpétuation de leur identité et la protection de leurs biens face à la pression démographique, foncière et politique de la colonie ». La politique de cantonnement, qui privait les musulmans d’une partie de leurs terres, fut dénoncée. Un sénatus-consulte accordera le 23 avril 1863 aux tribus la pleine propriété de leurs terres ancestrales, « dont elles ont la jouissance permanente et traditionnelle, à quelque titre que ce soit ». Un deuxième voyage de Napoléon III, cette fois-ci d’un mois, du 3 mai au 7 juin 1865, sera suivi le 14 juillet d’un sénatus-consulte accordant la nationalité française à tous, israélites et musulmans, sous réserve de ne plus revendiquer un statut personnel. Un an plus tard, les indigènes seront admis dans les conseils municipaux. Hélas pour le « royaume arabe », de 1866 à 1869, grande sécheresse et mauvaises récoltes vont engendrer une terrible famine. L’empereur fera voter de gros crédits pour la contrer, en vain. Le chiffre officiel de 215000 morts est sans doute largement au-dessous de la réalité.
Quelques mois après la chute de l’Empire, le décret Crémieux du 24 octobre 1870 accordera automatiquement la nationalité française aux indigènes israélites. Les musulmans, eux, craignaient qu’on ne les oblige tôt ou tard à abandonner leur statut personnel. Mais en attendant, l’idée
de se retrouver seuls à être considérés comme des citoyens de seconde catégorie ne leur convenait pas du tout. De plus, les bureaux arabes avec qui les chefs de tribus faisaient plutôt bon ménage commencèrent à être désavoués. Enfin, certaines dettes tardèrent à être honorées. Le 14 mars 1871, le chef des Beni- Abbès, Mohammed el- Hadj el- Mokrani, ancien allié de l’empereur, appela à la guerre sainte. Toute la Kabylie s’embrasa. El- Mokrani fut tué au combat le 5 mai, mais l’insurrection ne s’éteindra qu’en 1875.
D’énormes pénalités financières accableront les vaincus… De 1871 à 1875, la République ne cessera de promouvoir la petite colonisation paysanne en offrant à chaque candidat un terrain d’une quarantaine d’hectares. De son côté, l’armée matera encore quelques révoltes, ce qui lui laissera malgré tout le temps d’étendre jusqu’en 1902 ses territoires de commandement vers le sud, administrés par des officiers relevant des Affaires indigènes, épaulés par des unité méharistes.
D’une manière générale, l’amélioration de l’hygiène et le développement des voies de communication sont portés au crédit de la « civilisation ». Mais en 1891, Jules Ferry confessait que la République n’avait pas été à la hauteur en matière d’instruction des indigènes. « Ces regrets restent valables en 1914 », ajoute l’auteur du livre. D’autres inégalités ont perduré en matière de justice ou de fiscalité. La conscription obligatoire pour les musulmans en 1912 apportera quelques compensations, mais pas suffisamment. Il n’en demeure pas moins que ces troupes indigènes furent loyales et courageuses pendant ces années de guerre qui allaient terrasser l’Europe.
De bout en bout d’un récit captivant, Jacques Frémeaux fait honneur à la matière qu’il enseigne depuis des années à la Sorbonne. Avec une honnêteté sans faille, il s’attache à ne basculer que dans un seul camp, celui de l’Histoire, celle qui donne à réfléchir…