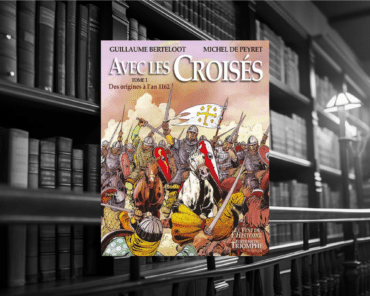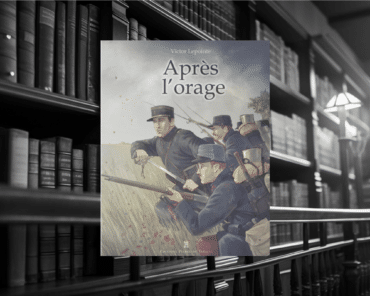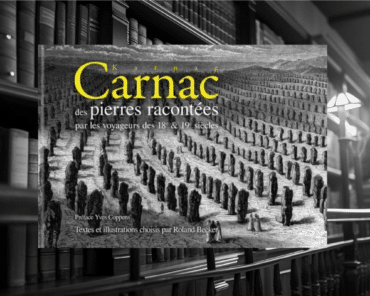Article publié dans Histoire Magazine N°10
Non dominant, mais omniprésent
Les débats sur la place de l’esclavage à Rome ont été durablement marqués par deux approches essentialistes complémentaires. La première, de type économique, a conduit à penser les sociétés pratiquant l’esclavage comme des «sociétés esclavagistes» où les esclaves sont des acteurs primordiaux de la production économique. La seconde, anthropologique, ne nie pas la réalité de l’esclavage, mais l’inscrit dans une organisation multiforme de sociétés complexes où la réalité de l’esclavage cohabite avec d’autres formes de dépendances et avec une population libre.
On estime aujourd’hui qu’il n’y avait pas plus de 30 à 40 % d’esclaves en Italie sous le Haut-Empire et que l’Empire romain, dans sa globalité, ne comptait pas plus de 15 à 20% d’esclaves. Mais, la crainte des Romains d’être submergés par la population servile était aussi une réalité. Sénèque le rapporte dans De la clémence à travers une proposition de sénatus-consulte qui aurait conduit à doter les esclaves d’un habit spécifique, affichant ainsi leur supériorité numérique. Leur importance croît avec les guerres contre Carthage et la conquête de l’Italie et du Bassin méditerranéen. À la différence d’une «société à esclaves», Rome accorde une place centrale à l’esclavage dans les processus de production et dans certains secteurs d’activité, comme dans les mines, l’agriculture et les manufactures (céramiques, tuileries, briqueteries, tissage, salaisons…). Il n’y a pas à Rome, à la fin de la République et sous l’Empire, de secteurs qui échappent à la présence servile, mais tous ne sont pas investis de la même manière et dans des proportions similaires. Quoi qu’il en soit, si les esclaves ne sont pas quantitativement majoritaires dans la société romaine (d’après Appien et Dion Cassius, une taxe de 100 sesterces prélevée en 42 avant notre ère rapporta 200 millions de sesterces soit deux millions d’esclaves), …
…le poids économique qu’ils représentent nous permet bien de qualifier la société romaine de «société esclavagiste». Pour autant, nous ne pouvons pas dire que, globalement, le mode de production y était un «esclavagisme».
Il faut tenir compte d’une grande souplesse de l’organisation économique qui s’appuyait sur une adaptation pragmatique du mode de production aux besoins et à la main-d’œuvre disponible : en période de raréfaction de l’approvisionnement en esclaves on assiste au développement de la dépendance de certaines populations libres, au recrutement de travailleurs libres ou de petits propriétaires salariés en complément lors des récoltes, des vendanges ou de certains travaux demandant précision et efficacité. Enfin, si on peut parler de société esclavagiste, c’est aussi parce que les Romains ont fait, à titre collectif et individuel, le choix d’utiliser des esclaves, non seulement pour des tâches domestiques ou productives, épuisantes et dégradantes, mais aussi dans le cadre d’activités de gestion, d’administration et de production intellectuelle ou artistique. Mais, avec le temps, l’esclavage cohabite de plus en plus avec d’autres formes de dépendances, complexifiant un peu plus la géographie sociale des statuts individuels et collectifs au sein de l’Empire romain.
Esclavage et empire global

Libre et esclave au travail ? La pharmacie romaine Musée d’archéologie nationale de Saint-Germain-en-Laye
Des marchés liés à la traite se développent parallèlement aux axes commerciaux, sur toutes les zones de contact entre le monde romain. Et les populations barbares contribuent à l’occasion à l’alimentation en esclaves, en pourchassant à l’intérieur des terres germaniques, asiatiques, africaines et bientôt bretonnes les populations qui fournissent les contingents serviles vendus et revendus sur les marchés d’esclaves. Le processus est globalisé, à l’échelle de l’Empire. Les IIe et Ier siècles avant notre ère constituent sans aucun doute l’apogée du trafic des esclaves, entre les chutes de Carthage et de Corinthe en 146 et la réduction des Gaules en 52. César, si l’on en croit Plutarque et Appien, fait alors converger plus d’un million de prisonniers vers l’Italie. Déjà, plus de 500000 prisonniers de guerre avaient été vendus comme esclaves entre 250 et 56 avant notre ère, sans compter tous ceux que la piraterie et le commerce font converger vers l’Empire. C’est à ce moment que se constituent en Italie les grandes familiae rusticae avec parfois plusieurs milliers d’esclaves. C’est aussi pendant cette période que la nature et la forme de la propriété foncière sont profondément bouleversées : la concentration foncière et financière appauvrit le tissu social des petits agriculteurs et artisans romains, malgré les tentatives (noyées dans le sang) de réforme agraire entreprises par les frères Tiberius et Caius Sempronius Gracchus, entre 133 et 123 avant notre ère. Enfin, les grandes révoltes d’esclaves de Sicile de 134-132 et de 104-101, mais surtout celle dite de Spartacus qui enflamme tout le sud de la péninsule Italienne de 73 à 71 avant notre ère, montrent que les structures socio-économiques de Rome et de l’Italie ont été profondément transformées par l’imposition d’un mode de production esclavagiste dans l’agriculture et dans certains types d’activités occupées jusque-là par une main-d’œuvre libre de petits propriétaires ou de petits artisans. Caton, un des plus anciens penseurs agronomes romains, préconise une économie rurale qui s’appuie sur l’exploitation maximale des esclaves et sur une rationalisation des tâches et des moyens de coercition. Varron (qui définit un esclavage par nature dans des termes assez proches de ceux d’Aristote) et Columelle pensent l’adaptation des rapports du maître à l’esclave en milieu agricole à l’évolution du type de propriété rurale idéal, au moment où la structure latifundiaire est critiquée, du moins pour l’Italie. La conception d’un esclavage « humanisé » est représentée par Pline le Jeune. À la fin du Ier siècle de notre ère, il dit n’employer «nulle part des esclaves enchaînés pour la culture», ajoutant : ici, en Toscane «personne ne le fait».

Épitaphe de Caius Silius Herma et de son esclave uerna (né à la maison). Urne en marbre Ier IIe siècle de notre ère. Musée Calvet, Avignon.
La Pax Romana entraîne la diminution des importations d’esclaves liées aux guerres, sauf en de rares exceptions du fait du renouveau des conquêtes sous Claude, Vespasien, Titus, Domitien, Trajan, MarcAurèle, par exemple. La piraterie, bien qu’affaiblie par Pompée entre 69 et 67 avant notre ère, continue d’être active sous l’Empire et alimente les marchés d’esclaves. Le brigandage, pratiqué dans tout l’Empire, y compris en Italie, alimente le commerce et les ergastules où l’on trouve les esclaves enchaînés. Les expositions d’enfants et l’autoreproduction (uerna, esclave né à la maison) apparaissent comme des moyens de substitution aux modes traditionnels d’approvisionnement. Pour lutter contre ce qu’Auguste percevait comme un amollissement de la romanité, des mesures en vue du rétablissement des valeurs morales sont adoptées, parmi lesquelles il faut retenir la limite en nombre et en âge (30 ans) apportée aux affranchissements par les leges Fufia Caninia (2 ap. J.-C.) qui limitent aussi le nombre d’affranchissements par testament. En l’an 4 de notre ère, les Aelia Sentia rejettent dans la classe des Latins Juniens les esclaves mal affranchis. Sous Tibère, la lex Iunia Norbana renforce la coercition.
L’idée d’un esclavage naturel
L’historiographie moderne et les sources classiques s’accordent pour que les premiers temps de la cité soient d’emblée marqués par une relation concrète avec l’esclavage qui est documenté pour l’époque royale, peut-être même dès Romulus. C’est un phénomène qui est présenté comme structurel à compter des premiers temps de la République. Sur un plan anthropologique, aux structures de parenté archaïque reposant sur un esclavage endogène de type domestique intégrant l’esclave (captiuus, mancipium, seruus, famulus) dans la familia (sous l’appellation de puer, sans doute le nom le plus ancien avec famulus pour désigner l’esclave et que nous retrouvons dans le suffixe — por Marcipor, esclave de Marcus par exemple), se substituent progressivement, en lien avec la conquête de l’espace italique puis méditerranéen, des formes externes d’esclavage basées sur l’« esclavage marchandise». Les besoins en main-d’œuvre ont pu être satisfaits, aux premiers temps de la cité, par la réduction en esclavage à la suite de guerres locales, d’une condamnation ou de dettes (nexum) qui permettent de s’approprier la force de travail en s’appropriant l’individu, même si les XII Tables, Tite-Live et Denys d’Halicarnasse présentent les nexi comme des «dépendants», notion qui n’équivaut pas à l’esclavage. Cependant, l’inaliénabilité progressive du nexum finit par créer une situation d’équivalence entre esclavage et nexum, lequel ne sera aboli officiellement qu’en 326 avant notre ère par la lex Poetilia Papiria (mais sans que la pratique disparaisse, comme l’atteste, à la fin de la République, la réduction en esclavage pour dettes d’adiudicati ou addicti, sans doute après des procès intentés par les créanciers).
Le sentiment de supériorité naturelle des Romains les conduit à doter les populations barbares d’une infériorité naturelle et culturelle, au sens qu’Aristote lui donne dans la Politique lorsqu’il détermine que certains naissent pour commander et d’autres pour obéir, puisqu’ils sont instruments animés, objets de propriété. Toutefois, cette conception est très tôt limitée par le fait que l’esclave affranchi intègre une nouvelle place dans la familia de l’ancien maître (dominus) qui devient son patron (patronus). L’affranchi (libertus) lui doit encore des services (obsequium, officium, bona, operae), qui sont la preuve de son ancienne servitude et de sa nouvelle dépendance. L’affranchissement (manumissio) pouvait être obtenu sous cinq formes: la vindicte fait intervenir une tierce personne qui revendique devant le préteur la liberté de l’esclave ; le cens sous la forme d’une inscription autorisée par le maître auprès des censeurs; le testament entre amis; le partage de la table. Les deux dernières formes relèvent d’une manumission juridiquement informelle. Auguste, avec la lex Aelia Sentia, réaffirme les droits du patron et les devoirs de l’affranchi dans un sens coercitif. Les liberti reçoivent les droits civils du citoyen, mais ne peuvent intégrer le cursus honorum. L’empereur interdit les mariages avec des membres de l’ordre sénatorial. Or, dès 312 avant notre ère, un fils d’affranchi (libertinus) d’Appius Claudius Caecus, Cnaeus Flavius devient édile curule. En 304, en réaction à la politique d’Appius Claudius, les censeurs inscrivent tous les affranchis dans les quatre tribus urbaines pour limiter leur influence politique. Puis de nombreuses propositions de loi (en 230, 179, 174, 169, 115, 88, 87, 81, 66, 63) tentent de déterminer le cadre d’inscription des affranchis dans les tribus romaines et de les intégrer au jeu politique. Sur la longue durée, l’accroissement des affranchissements, malgré une taxe de 20 % créée en 357 avant notre ère, a toujours été précédé d’une forte augmentation du nombre d’esclaves, soit par la conquête, soit par de vastes opérations de piraterie. Des marchés comme celui de Délos, jusque vers les années 70 avant notre ère, pouvaient procéder à la vente de 10 000 esclaves par jour, si l’on en croit Strabon.
Une amélioration lente et partielle de la condition servile?
Comme tous les faits sociaux, l’esclavage n’est pas uniforme sur une période historique de longue durée comme fut celle de l’histoire de Rome et de son Empire, soit plus de mille ans. L’origine des esclaves, leur nombre, leur affectation dans les activités du monde romain et même les contours juridiques de leur statut évoluent dans le temps.
Globalement, une ligne directrice les sépare d’abord radicalement et juridiquement du corps des hommes libres et des citoyens. Puis ils finissent par cohabiter avec de nouveaux groupes de dépendants, à la fin de l’Antiquité. Les esclaves constituent un groupe bien distinct au sein de la société romaine. Mais il est hétérogène.
Comme le reste de la société, le groupe des esclaves est traversé par des inégalités de fonctions, de traitements et de récompenses, voire de rémunération (pécule, préposition).
L’agriculture, l’artisanat, la domesticité comme le commerce et l’administration distinguent une hiérarchie de fonctions et de responsabilités qui rapproche ou éloigne les esclaves de l’affranchissement. Mais attention : un esclave reste un esclave et le meilleur d’entre eux sera toujours perçu comme un être inférieur, un instrumentum uocale malgré «l’humanisation» progressive de leur condition, par ailleurs seulement vraiment reconnue à partir d’Hadrien, suite à un long processus de réflexion sur l’horreur de la répression. Notamment avec le débat autour de l’application du senatus consultum sylanianum, qui permet d’exécuter sous Néron, malgré l’opposition de la plèbe, 400 esclaves de Pedanius Secundus accusés collectivement du meurtre de leur maître.
Le processus est donc long, car depuis Platon et Aristote, les philosophes ont été confrontés à cette aporie qui veut que l’esclave, perçu et utilisé comme une chose (res) soit aussi un être humain. Cette humanité de l’esclave conduit les Romains à penser l’esclavage comme une situation anormale pour un Romain, même s’il existe marginalement des cas d’esclavage volontaire ou d’auctoratio (engagement volontaire comme gladiateur). Si le Romain ne peut être réduit en esclavage, l’étranger, le Barbare, est quant à lui naturellement destiné à l’esclavage. Encore faut-il nuancer. Les Orientaux, les Africains, les Germains sont considérés comme étant beaucoup moins intégrables que les populations de l’Europe continentale occidentale.

Esclave battu par son maître. Mosaïque de la villa Casale, Armerina, Sicile. Fin du IIIe siècle.
C’est pourquoi les Romains ouvriront les portes de la citoyenneté aux affranchis, mais selon des modalités, des quotas et des rythmes irréguliers. Si, à l’origine de la Cité, les besoins en population ont conduit à une assimilation pure et simple de certains esclaves dans le corps civique, l’histoire de Rome voit se multiplier les verrous pour une accession directe à la citoyenneté. Une fois de plus, c’est le travail accompli qui préfigure l’éventuel affranchissement. On sait qu’appartenir à une riche domus urbaine ou occuper des fonctions administratives d’importance au service de la cité (serui publici), de l’Empereur (serui Caesaris), d’un riche notable ou d’un entrepreneur, favorise l’affranchissement. Un esclave de la familia rustica a certes beaucoup moins de chance d’être affranchi, mais il existe un certain espoir pour des esclaves non enchaînés. La présence de uilici (contremaîtres) affranchis prouve que, même dans les campagnes, l’affranchissement se pratique. Toutefois, n’allons pas croire que l’esclavage est une propédeutique de la liberté pour des peuples qui auraient été insuffisamment préparés à l’exercice de la libertas.
Un phénomème malgré tout accepté
On s’est beaucoup étonné qu’il n’y ait pas eu de condamnation franche de l’esclavage de la part des philosophes ou des hommes de culture, qu’ils soient grecs ou romains. Cela serait oublier qu’avant tout l’esclavage est un fait de société. Depuis sa formalisation par Aristote, il est pour la plupart des penseurs de l’Antiquité étroitement justifié ontologiquement comme naturel. En plaçant certaines formes d’esclavage du côté de la « loi », dans la cité, les penseurs antiques le dissocient progressivement d’un esclavage par «nature». L’ancrage historique de l’esclavage n’empêchera pas la théorie de l’esclavage par nature de traverser l’Antiquité et d’être encore un sujet de controverse à la fin de l’Antiquité chez les auteurs chrétiens (Origène, Lactance, Athanase, Augustin) qui discutent de la place de l’esclavage dans une société christianisée. Ils développent une conception de l’esclavage comme fait naturel (Philon d’Alexandrie, Ambroise, parfois Augustin) ou résultat d’une contrainte sociale (Florentinus, Basile, Augustin), où la domination du pater familias sur le fils et celle du dominus sur le seruus sont comparées. Ainsi, l’esclavage est une réalité avec laquelle il faut composer. Deux tendances fortes peuvent être dégagées au cours de l’histoire de Rome et de son Empire. Un premier mouvement repose sur le prolongement romain d’une pensée grecque sur l’esclavage et sur l’acceptation d’un état de fait : l’esclavage existe, il faut vivre avec et l’utiliser au mieux des intérêts de la cité et des propriétaires.
L’évolution perceptible du rapport à l’esclavage et aux esclaves n’exclut pas une revendication d’un esclavage par nature dont la position est défendue par Laelius dans le De Re publica de Cicéron. Un siècle plus tard, Paul de Tarse et ses disciples acceptent la réalité de l’esclavage, mais la replacent dans une conception dialectique entre monde terrestre et royaume céleste où l’esclavage serait aboli en Dieu.

Pâtres et troupeaux. Illustration du Vergilius Romanus, première moitié du Ve siècle de notre ère (Bibliothèque Apostolique du Vatican)
L’équilibre d’une soumission servile et d’une bonne conduite des maîtres a été parfois perçu comme un conformisme social et une contra- diction dans le développement d’une pensée chrétienne. La complémentarité naturelle entre domination et obéissance permet à des auteurs juifs (Philon d’Alexandrie) ou chrétiens (Ambroise, Augustin, Athanase) d’accepter l’esclavage et la différence de statut. Si Lactance, à la fin du IIIe siècle, et surtout Grégoire de Nysse, au IVe siècle de notre ère, critiquent de manière assez virulente les comporte- ments esclavagistes, ils ne remettent pas pour autant en cause la réalité de l’esclavage. Les seuls, peut-être, à ne pas pratiquer l’esclavage sont les esséniens et les thérapeutes chez les Juifs et certains cyniques.
La seconde attitude revient à accepter la réalité de l’esclavage, mais à tenter de «l’humaniser» en tenant compte des évolutions de la société et des erreurs qui ont pu être com- mises, car un esclave est certes un bien (res), mais aussi une personne. C’est la position de Cicéron dans son cinquième Paradoxe des Stoïciens. Sénèque, dans les Lettres à Lucilius, expose une doctrine propre au stoïcisme qui insiste sur l’ontologique humanité de l’esclave et sur un esclavage métaphorique nous soumettant à nos passions. Les stoïciens n’ont pas cru à un esclavage par nature, et ceci, sans doute, dès Zénon et Chrysippe. Esclavage légal et esclavage moral, contrainte extérieure et contrainte intérieure, peuvent cohabiter chez un même individu, mais pour le stoïcien, c’est l’esclavage moral qui doit être combattu.
Paul, influencé par le stoïcisme, puise son registre métaphorique dans la multiplicité des usages grecs et hébreux de doulos/ebed dans l’Ancien Testament. Cette soumission qui faisait des chrétiens des esclaves serviteurs de Dieu et libres en Dieu choquait les stoïciens pour qui l’esclavage est négatif, bien qu’il existât dans la pensée juive un usage métaphorique de l’élection. Fondateur de l’approche quiétiste des Pères de l’Église quant à la question de l’esclavage, Paul néglige l’esclavage réel au profit du salut, comme les stoïciens négligent le même esclavage au profit de la vertu. Ambroise, dans ses Lettres, à la fin du IVe siècle, s’inscrit dans la pensée du stoïcien Épictète et affirme : «ce n’est pas natura qui fait de l’homme un esclave, mais folie, tout comme ce n’est pas la manumission qui fait d’un homme un homme libre, mais la sagesse». Dans une forme d’abou- tissement, Augustin donnera une interprétation anthropocentrique de l’esclavage. Ce dernier naît du mauvais usage du libre arbitre accordé par Dieu, car Dieu ne peut être injuste.
L’influence du stoïcisme romain conduit à une amélioration de la condition d’esclave. Le droit en fait progressivement état.
Gaius, dans ces Institutes, au IIe siècle de notre ère, précise un comportement plus correct envers les esclaves au nom des prérogatives et des droits du citoyen, donc des maîtres. Toutefois, à la fin de l’Antiquité, le problème reste entier. Le maître comme le père règne toujours en fonction de l’autorité qui lui est conférée par la tradition, les usages, l’histoire et la prescription divine. Et nul n’envisage encore l’abo- lition de l’esclavage.